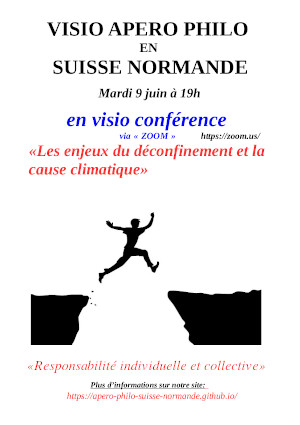Les enjeux du déconfinement et la cause climatique
Pour cause de pandémie de COVID-19, l’Apéro-Philo se déroulera sur Zoom et non pas à l’Epicerie du Coing de Pont d’Ouilly
Responsabilité individuelle et responsabilité collective
- Responsabilité individuelle et responsabilité collective
- 1. Coronavirus : « Le virus ne va pas disparaître cet été » selon Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France
- 2. Penser l’après Covid 19.
- 3. Scénarios possibles pour payer la facture de la crise
- 4. Pablo Servigne présente l’entraide
- 5. Confinés puis déconfinés, nous avons été ou nous sommes.
- 6. Coronavirus : cinq stratégies pour juguler sa propagation
- 7. Coronavirus : comment sont comptés les morts dans le monde ?
- 8. Le confinement, bon pour la qualité de l’air
- 9. Coronavirus : le point sur les traitements et vaccins
- 10. Contribution de la Convention Citoyenne pour le Climat au plan de sortie de crise
- 11. Les arbres, une arme contre le réchauffement climatique
- 12. Un avant-goût du choc climatique
- 13. Les stratégies adoptées dans différents pays pour lutter contre le covid-19
- 14. Alain Supiot : « Seul le choc avec le réel peut réveiller d’un sommeil dogmatique »
- 15. Un peu d’humour dans ces moments difficiles : Les gestes barrières
- 16. Compte-rendu de la séance Apéro philo qui a eu lieu en visiozoom le 9 juin 2020
1. Coronavirus : « Le virus ne va pas disparaître cet été » selon Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France
Auditionné par la commission des Affaires sociales du Sénat, le microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses et professeur au Collège de France, Philippe Sansonetti, a affirmé que le/la Covid-19 a très peu de chances de devenir une maladie saisonnière.
Document de Public Senat, le 30 avril 2020
À défaut de compter sur l’immunité collective, la saisonnalité pourrait être une piste pour endiguer le Covid-19. Selon le professeur marseillais Didier Raoult, le Covid-19 est une « épidémie saisonnière » qui devrait cesser de circuler dans les pays tempérés d’ici un mois. Autrement dit, avec l’arrivée de l’été le virus pourrait disparaître, comme ce fut le cas pour «l’ancêtre» du Covid actuel, le SARS, qui a complètement disparu de lui-même.
« Nous ne sommes pas face à une grippe hivernale »
« Il ne faut pas se bercer d’illusions » répond Sansonetti devant les sénateurs. « Le virus ne va pas disparaître cet été comme certains l’espèrent. Nous ne sommes pas face à une grippe hivernale. Il n’y a rien d’écrit dans le génome du Covid-19 qui permette de dire s’il est programmé pour une saisonnalité ou pas. Il est affecté par la température et l’humidité, mais pas au point de disparaître pendant la saison estivale » estime-t-il. « En Espagne, en Italie, au moment où le virus était le plus virulent il faisait déjà 25 degrés et ce virus est présent partout dans le monde y compris dans des pays chauds donc on ne voit pas en quoi la température aurait une influence quelconque sur l’épidémie. » Alain Milon, président de la commission des Affaires sociales au Sénat, dit regretter « cette cacophonie » au sein du monde médical, avec certains médecins qui font passer le Covid pour une « grippette » « Cela n’aide pas nos concitoyens à y voir clair, c’est même anxiogène. »
Un traitement pour diminuer la mortalité
En attendant un vaccin, le professeur assure qu’il est impératif de trouver un traitement efficace pour soigner les formes graves, seule façon de « diminuer le recours à la réanimation ou encore à la ventilation mécanique pour les patients Covid-19 » explique-t-il. « Et par conséquent de diminuer drastiquement le nombre de morts. Cela dédramatiserait la pathologie, on pourrait alors davantage le comparer à une grippe et cela améliorerait considérablement la situation » précise Philippe Sansonetti. Sans la possibilité d’atteindre l’immunité collective « au coût humain et médical épouvantable », la seule façon d’éradiquer le virus reste le vaccin affirme le microbiologiste « surtout dans les pays à faibles ressources. » « Tout est fait pour accélérer sa mise sur le marché. Les choses pourront aller plus vite que d’habitude mais laissons le temps à la science. Les chercheurs avancent mais tous sont unanimes : il va falloir plusieurs mois pour le mettre au point, il ne permettra donc pas d’enrayer l’épidémie de coronavirus actuelle.» Selon le professeur, « il pourrait s’écouler au moins un an avant qu’un vaccin contre le Covid-19 ne soit prêt pour approbation et disponible en quantités suffisantes pour permettre une utilisation généralisée ». Pour les plus optimistes, un premier vaccin pourrait être disponible dès l’automne 2020.
Un rebond inévitable sans déconfinement réussi
Interrogé sur le plan de déconfinement du gouvernement, il a défendu le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics, l’un des moyens de réussir ce déconfinement. « On ne peut pas se rater, la communication a été défaillante au début, il faut maintenant des consignes claires sinon nous aurons un rebond du virus.» Sur le dépistage de la population qui a suscité de nombreuses questions des sénateurs, le professeur a répété que « si on ne teste pas on pilote à l’aveugle, on manque de diagnostic. Nous aurions du dépister davantage plus tôt. » Ajoutant que dans les pays où la mortalité est la moins forte sont ceux qui ont testé massivement. « Nous devons maintenant le faire en prenant en compte les porteurs sains et en les isolant pour éviter la contamination. »
2. Penser l’après Covid 19.
Jean-Marc Jancovici argumente pourquoi un retour à l’avant crise sanitaire est impossible. Il explique pourquoi il n’y aura pas de redémarrage de l’économie et plusieurs millions de chômeurs en plus : en particulier parce que nous nous heurtons à une raréfaction des ressources ce que n’a jamais pris en compte la théorie économique puisque cette dernière ne parle que d’une combinaison entre capital et travail. Du fait de ce manque physique de ressources, la croissance ne peut être perpétuelle. Le Covid 19 n’a fait que s’inscrire dans cette évolution. Les élites pensent pouvoir faire redémarrer l’économie comme avant, mais même si cette dernière enregistre encore quelques soubresauts, l’issue restera fatale. Du coup la confiance dans ces élites s’étiole puisqu’il faut que nous vivions non seulement dans un monde qui n’est plus en croissance mais risque d’être en décroissance… Le grand défi de ce qui nous arrive est de vivre dans ce monde nouveau. Que faire dans ces conditions ? Jean-Marc Jancovici répond aux très nombreuses questions des étudiants de Sciences Po…
3. Scénarios possibles pour payer la facture de la crise
Dans un article publié dans le journal « Les Echos » le 2 avril dernier, Jean Tirole, prix nobel d’économie 2014, nous décrit quatre scénarios possibles pour payer la facture de la crise : répudiation de la dette accumulée, monétisation de cette même dette, création d’impôts exceptionnels ou solidarité entre Etats. Il nous donne également son avis sur la solution qui sera la plus probablement mise en œuvre.
D’un point de vue économique, la crise liée au Covid 19 diffère de celle de 2008. Dans cette dernière, des banques mal régulées et ayant pris des risques excessifs étaient au bord de la faillite. Cette faillite pouvait, par effet de domino, contaminer d’autres banques créancières des premières et les amener à leur tour à fermer. L’inquiétude était que ces faillites, ou à un degré moindre la réduction des activités de crédit, n’affectent les entreprises, en particulier les PME, qui auraient été asphyxiées par le tarissement de leurs financements bancaires, impliquant réduction de l’activité et chômage en bout de ligne.
La situation aujourd’hui est différente. Ce sont les entreprises qu’il faut sauver. Ces dernières réduisent leur activité, soit parce que les services qu’elles produisent créent des risques importants de contamination des clients (restaurants, spectacles…), soit parce que leurs conditions de production nécessitent une proximité des travailleurs (usines). Avec un effet de ricochet inversé et des banques fragilisées par les moratoires sur les paiements des dettes qui leur sont dues et plus généralement par les pertes sur leurs actifs. Ceci explique que le plan de sauvetage porte à la fois sur les entreprises et sur le système financier.
Estimation du coût économique de la crise
Il est difficile d’en prédire le coût direct. Mes collègues à Toulouse School of Economics, Christian Gollier et Stéphane Straub, proposent une estimation « à la louche » fondée sur l’hypothèse d’un confinement de deux mois et réduisant de moitié l’activité économique, soit l’équivalent d’un mois de perte économique ou 8 % du PIB annuel. Sachant qu’il faudra de douze à dix-huit mois afin de développer un vaccin, l’on n’ose imaginer le coût que représenterait un confinement alterné comme envisagé dans l’étude très influente d’Imperial College. Cette étude considère entre autres un confinement intermittent de deux mois sur trois, les mesures étant temporairement assouplies avant d’être réintroduites quand les contaminations repartent à la hausse.
A ces coûts directs s’ajoutent les coûts indirects, encore plus difficiles à chiffrer mais sans doute conséquents. L’activité après une crise ne repart pas du jour au lendemain.
Un scénario sombre
Si la crise sanitaire se prolongeait, les marchés financiers pourraient perdre confiance dans la valeur des obligations émises par les Etats, faisant planer le risque de crises souveraines.
Pour comprendre pourquoi, partons des sommes colossales que l’Etat devra dépenser pour sauver l’économie. L’Etat et la Banque Centrale aujourd’hui jouent à juste titre leur rôle d’assureur en dernier ressort en venant à l’aide des plus fragiles. Saluons au passage la solidarité dont ont fait preuve les gouverneurs de la BCE en débloquant rapidement des sommes très importantes pour assurer la stabilité financière.
Ces mesures de soutien budgétaires et monétaires viennent aider les travailleurs économiquement fragiles (CDD, salariés en fin de période d’essai, chômeurs perdant leur éligibilité à l’assurance chômage) qui, en faisant tous les efforts possibles, ne retrouveront pas d’emploi ; les indépendants confinés ou sans clientèle qui perdent leur source de revenus ; les PME et autres entreprises financièrement fragiles ; les banques et les assureurs, eux aussi durement touchés par la crise ; et enfin, dans la zone euro, les Etats dont la solvabilité peut être remise en question.
La dette des Etats va enfler, comme il est normal en temps de crise ou de guerre. Si la crise sanitaire perdure, certains Etats surendettés pourraient avoir de fortes difficultés à faire de nouveaux emprunts ou même simplement à renouveler ceux arrivés à terme ; ils seraient alors dans l’incapacité de financer les nouvelles dépenses de santé, de payer leurs fonctionnaires et fournisseurs, ou de tenir les promesses faites aux particuliers, entreprises, banques et compagnies d’assurances pour éviter faillite et chômage.
Cette problématique prend une dimension particulière en Europe. La France n’a pas équilibré un budget depuis quarante ans et a vu ses dettes, officielle et non comptabilisée (le « hors-bilan » : garanties diverses, déficits des régimes sociaux, retraites, etc.), augmenter lentement, mais inexorablement. Et elle n’est pas le plus mauvais élève. La Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Italie et le Portugal dépassent aussi les 100 % du PIB en dette publique, pour certains beaucoup plus que la France.
Comme je l’explique dans Economie du bien commun, il n’y a pas de chiffre magique pour le maximum de dette qu’un pays peut soutenir. Si la pérennité financière d’un pays dépend de facteurs spécifiques bien identifiés (par exemple, un taux de croissance élevé et des taux d’intérêt bas, une capacité à augmenter l’impôt si nécessaire, une forte fraction de la dette détenue domestiquement), les attaques spéculatives sont aussi un phénomène autoréalisateur, donc difficilement prédictible.
Quand un pays entre dans une zone où sa viabilité financière est en question, les investisseurs étrangers retirent leur argent s’ils pensent que le pays va faire défaut et restructurer sa dette, ce qui est effectivement le cas si les autres intervenants sur les marchés financiers font de même ! Une dette élevée n’est pas rédhibitoire tant que les marchés gardent confiance dans les Etats, mais devient critique autrement. Ironiquement, la croyance forte dans l’innocuité de l’endettement, reflétée de façon spectaculaire dans les divers programmes populistes des présidentielles de 2017 et de façon atténuée dans la vision de notre establishment depuis des décennies, pourrait justement mettre le destin du pays dans les mains de marchés financiers internationaux dont ils se méfient considérablement !
Pour éviter une telle situation, l’aide au niveau microéconomique doit être généreuse seulement pour les personnes et les entreprises qui en ont le plus besoin. Par exemple, l’envoi d’un chèque pour tous n’aurait pas beaucoup de sens ; il n’y a pas besoin d’aider ceux qui ne sont pas en difficulté ou les entreprises qui ont peu souffert de la crise sanitaire. Au niveau macroéconomique, il faudra pour relancer l’activité dépenser pendant longtemps en s’affranchissant des règles budgétaires habituelles. Raison de plus de résister à la tentation de l’open bar.
De plus, en consultation avec les autorités sanitaires, il faudra faire en sorte que, dans le respect de la protection de la santé des individus, l’interruption d’activité ne perdure pas. Une période de confinement de plusieurs mois comme envisagée par les scénarios du rapport d’Imperial College serait extrêmement coûteuse ; de plus plane le risque d’un non-respect des consignes, voire d’une désobéissance civile de grande ampleur par des citoyens excédés par l’absence d’interaction sociale directe et un ennui profond, quand ce ne sont pas les difficultés financières. Elle aurait aussi des conséquences invisibles à court terme, mais très coûteuses à long terme, comme le retard éducatif pris pendant cette période.
Il n’y a aucune raison que les personnes ayant développé une défense immunitaire au Covid-19 ne se voient pas décerner un laissez-passer et ne retournent pas au plus vite à leur activité. Mais cela nécessite des tests . En fait un double test, comme le préconise une équipe de l’Université Libre de Bruxelles : l’un pour déterminer l’immunité de l’individu (test sérologique) et l’autre vérifiant qu’il n’est plus porteur du virus (test RT-PCR). Une mise en oeuvre progressive de ces deux tests permettrait de maintenir l’activité économique tout en minimisant le risque d’un retour en force de l’épidémie lorsque les mesures de confinement seront levées.
D’autres propositions ont été faites allant dans le même sens. Les laissez-passer octroyés aux individus immunisés et non-porteurs pourraient être complétés par des tests hebdomadaires, des capteurs thermiques, le traçage GPS des téléphones (sous strict contrôle pour protéger la vie privée des individus), et toute autre méthode permettant de protéger de l’épidémie ceux qui ne sont pas encore immunisés. Des mesures simples comme un dépistage systématique suivi d’un traçage et la mise en quarantaine des contacts et collègues de travail de l’individu contaminé semble avoir porté des fruits en Allemagne.
Qui va payer ?
In fine, quelqu’un paiera cette perte d’activité. Il y a plusieurs hypothèses et bien malin celui qui peut prédire celles qui prévaudront.
Première hypothèse : la répudiation de la dette publique existante (appelée en termes pudiques « restructuration »). C’est une solution très risquée, car la confiance en l’Etat en serait affectée. Ne pouvant plus emprunter, cet Etat serait obligé d’équilibrer son budget immédiatement, ce qui serait particulièrement délicat à un moment où il faudra continuer à payer les dépenses courantes, relancer l’économie, investir dans les hôpitaux et la recherche médicale, récompenser le personnel de santé pour son travail pendant la crise sanitaire, mettre en oeuvre les réformes structurelles, etc.
Deuxième hypothèse : L’impôt. Les Etats dégonflent la dette publique en diminuant les dépenses ou en augmentant les impôts. Les Etats prélèvent des taxes exceptionnelles sur les plus aisés, par exemple sur le patrimoine, ainsi que, pour faire face aux forts besoins en finances publiques, sur les classes moyennes.
Une forme déguisée de l’impôt est la création d’une souscription obligatoire des banques à de nouvelles émissions de bons du Trésor, ceci à des taux d’intérêt ne reflétant pas l’inflation qui s’ensuit. L’inflation est en effet un grand classique de l’après-guerre. La dette publique accumulée est résorbée en forçant les banques à acheter cette dette à un prix surévalué (c’est ce que les économistes appellent la « répression financière ») : les nouveaux emprunts de l’Etat sont bon marché pour ce dernier. C’est ainsi que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont réduit leur dette publique au sortir de la grande dépression et la deuxième guerre mondiale.
Ceci dit, une souscription obligatoire serait particulièrement délicate en zone euro. Elle nécessiterait un accord entre les pays sur le degré de répression financière autorisé dans chaque pays. De plus, elle perpétuerait et aggraverait même une forme de prise de risque déjà acceptée par les autorités prudentielles depuis la crise de la zone euro, et ce dans un contexte où les banques sont fragilisées par la crise sanitaire.
Ce dernier point est un peu technique. Aujourd’hui, à titre d’exemple, les banques italiennes possèdent beaucoup de dette de l’Etat italien. Bien que la valeur de la dette publique italienne pourrait diminuer du fait d’une restructuration possible de cette dette, les régulateurs bancaires n’exigent pas d’elles d’avoir des fonds propres leur permettant de résister à une perte de valeur de cette dette. Ce manque de fonds propres, qui s’applique aux dettes des pays de l’OCDE en général, est particulièrement risqué dans le cas de la dette de l’Etat italien, car les difficultés du pays rejaillissent sur les banques, et vice-versa le renflouement des banques insolvables aggrave les problèmes de finances publiques (les économistes appellent ce phénomène la « boucle de la mort »). Une souscription obligatoire augmenterait la quantité de dette italienne détenue par les banques italiennes et la surévaluerait dans leurs bilans en négligeant les pertes futures dues à l’inflation et à la possibilité de restructuration.
Troisième hypothèse : la monétisation de la dette. La Banque Centrale rachète de la dette publique (ou la dette de banques que l’Etat soutiendrait de toute façon en cas de difficulté). Cette dette en principe doit se faire sur le marché secondaire et être remboursée à terme. Ces deux contraintes sont cependant plus formelles que réelles : la nouvelle dette italienne peut être achetée sur le marché primaire par une banque italienne qui la vend ensuite à la BCE (la frontière entre marchés primaire et secondaire, entre achats et rachats, est poreuse). Et il n’y a pas d’échéance formelle pour le remboursement par les Etats ; un rachat supposé temporaire peut de facto devenir permanent.
Les rachats de dette par la Banque Centrale sont présumés inflationnistes. Mais il y a débat quant à la reprise de l’inflation. Il n’y eut pratiquement pas d’inflation suite à l’« assouplissement quantitatif » par les banques centrales en réponse à la crise des subprimes. Les banques centrales procédèrent à des rachats massifs de dette publique et bancaire après 2008. Cet accroissement considérable de liquidité aurait dû augmenter la demande, poussant les prix à la hausse. C’était cependant oublier les anticipations déflationnistes et la thésaurisation par les ménages, entreprises et institutions financières (les banques en particulier accumulant des réserves auprès de la Banque Centrale). L’inflation pourrait-elle redémarrer demain après une forte création de monnaie par la banque centrale ? Nul ne le sait. Si cela devait arriver, les « payeurs » seraient les détenteurs de fonds en euros et de comptes courants, qui, à l’exception de rares emprunts indexés à l’inflation, sont libellés en valeur nominale.
La monétisation de la dette pourrait être une option intéressante, mais à deux conditions. La première est de faire attention aux plus démunis, dont les seules économies se trouvent être logées dans un compte en banque. La seconde, et « l’éléphant dans le magasin de porcelaine » dans le cas de la zone euro, est de garder la discipline budgétaire au sein de la zone euro, dans une situation où tout gouvernement pourra dépenser librement en en mutualisant les conséquences avec les 18 autres pays de la zone. Il faudra pour cela réinventer le Pacte de stabilité, pour qu’il permette les fortes dépenses nécessaires au redémarrage de l’activité tout en gardant pérenne cette solidarité. Les monétisations de dettes publiques dans le passé n’impliquaient pas plusieurs pays, une monnaie unique, une banque centrale commune, et des niveaux de dette et de tolérance à l’inflation très différents selon les pays.
Quatrième hypothèse : la solidarité entre pays, c’est-à-dire l’acceptation par les pays dont les finances publiques sont restées solides de se porter garantes d’autres pays plus fragiles. Cette solidarité peut être difficile à mettre en oeuvre à un moment où tous les pays sont fortement impactés par le coronavirus. Mais il y a des antécédents, tel que le plan Marshall après la deuxième guerre mondiale (avec des visées géopolitiques, comme pourrait en avoir aujourd’hui la Chine) et la solidarité européenne dans la crise de l’euro lors de la dernière décennie face à des attaques spéculatives mettant l’Europe du sud en difficulté. L’argument en faveur de la solidarité européenne est encore plus fort que dans le passé. Par exemple, l’Italie n’est pas responsable de la pandémie. Cependant, au moment même où l’Europe devrait se porter totalement solidaire, cette même Europe pourrait être réticente à le faire, car l’Italie a abordé la crise sanitaire avec un endettement excessif.
Plusieurs mécanismes de mutualisation sont en place dans la zone euro. J’ai déjà mentionné les mécanismes de rachat de dette bancaire et souveraine par la BCE. Le Mécanisme européen de stabilité lui permet de lever jusqu’à 700 milliards d’euros sur les marchés financiers, grâce à une garantie de l’Union Européenne, mais est difficile à mettre en oeuvre car il requiert l’unanimité des 19 ministres des finances de la zone euro. De plus, il ne peut aider les Etats et les banques en difficulté que sous conditions.
Un troisième mécanisme, la mutualisation de la dette, est sur la table : de nombreuses voix – ainsi que neuf pays d’Europe du sud, dont la France – ont proposé une émission jointe de « coronabonds », reprenant ainsi l’idée des « eurobonds » qui avaient joui d’une certaine popularité après la crise de 2008, mais n’avaient pas vu le jour.
La mutualisation des dettes serait bénéfique à l’Europe du sud, mais elle me semble comme dans le passé peu probable. Comme je l’ai exprimé dans ma recherche, la solidarité est plus facile à organiser quand les pays sont de solidités financières similaires, c’est-à-dire quand chaque pays peut être le bénéficiaire comme le perdant de la solidarité. De même que vous ne signerez pas un contrat d’assurance nous portant garants l’un de l’autre si vous savez que je croule sous les dettes, il est peu attrayant de s’engager à partager le risque de l’emprunt avec des pays déjà surendettés. L’asymétrie des points de départ autorise toujours une forme de solidarité mue par l’empathie ou les intérêts bien compris (conséquences géopolitiques ou pertes économiques liées à un défaut de paiement de l’autre pays), mais cette solidarité, que l’on a observée dans la crise grecque, est nécessairement limitée.
Le soutien par la BCE me semble donc plus probable qu’un soutien budgétaire : il est plus rapide à mettre en place, ne requiert pas l’unanimité, et surtout il est moins transparent pour les opinions publiques des pays de l’Europe du nord, moins endettés (l’Allemagne a réduit sa dette à moins de 60 %) et inquiets d’avoir à financer l’Europe du sud.
Jean Tirole
4. Pablo Servigne présente l’entraide
Pablo Servigne (ingénieur agronome qui s’intéresse aux questions de tansition écologique, agroécologie, collapsologie, résilience collective…)
5. Confinés puis déconfinés, nous avons été ou nous sommes.
Du coup l’Etat nous impose des gestes barrières ainsi que des restrictions de liberté, de circulation, etc… Tout cela sont des violences ! Or que savons nous du rôle de la violence dans la culture humaine ? Le sociologue, anthropologue, philosophe, René Girard, aujourd’hui disparu prend la parole à l’Ecole Normale Supérieure en décembre 2007. Il nous y expose ses théories sur la violence en évoquant notamment le mimétisme, l’exogamie, les échanges, les rivalités, les interdits, l’existentialisme, l’oedipe, les sacrifices, les risques, les mythes, les religions, etc… A nous d’adapter, le cas échéant, ses dires à la situation que nous connaissons aujourd’hui…
6. Coronavirus : cinq stratégies pour juguler sa propagation
Par Lioman Lima BBC News – 29 mars 2020
Certains pays semblent avoir contenu la propagation rapide du coronavirus, tandis que d’autres luttent avec plus de cas chaque jour. Quelles sont donc les stratégies qui fonctionnent ?
Le coronavirus s’est propagé dans le monde entier, provoquant la panique autour de la planète: des milliers de nouveaux cas et des centaines de décès sont annoncés chaque jour. De nombreuses villes - et des pays entiers - sont confinés, des annulations de vols, des événements internationaux et festivals annuels.
L’Europe est devenue le nouvel épicentre de la maladie, tandis qu’ailleurs - en Amérique latine, aux États-Unis et au Moyen-Orient - le taux d’infection augmente quotidiennement.
Pourtant, certains pays semblent avoir réussi à contenir la propagation brutale du virus qui, au 23 mars, avait tué quelque 15 000 personnes et infecté plus de 340 000 autres dans le monde.
Plusieurs pays asiatiques, malgré leur proximité géographique avec la Chine (où la maladie a commencé), montrent la voie à suivre pour freiner le taux d’infection du Covid-19.
“Il y a des nations qui ont réussi à prendre des mesures pour contenir l’épidémie, et je pense que nous devrions en tirer des leçons”, a déclaré à la BBC l’épidémiologiste Tolbert Nyenswah, professeur à l’Université Johns Hopkins aux Etats-Unis, ancien ministre de la santé du Liberia et ancien directeur de l’équipe multinationale qui a lutté contre la pandémie d’Ebola en Afrique.
“Je ne parle pas seulement de la Chine, où le nombre de cas a diminué après avoir appliqué des mesures extrêmement agressives que d’autres pays démocratiques pourraient ne pas trouver faciles à appliquer”, a-t-il déclaré.
“D’autres pays ont opté avec succès pour différentes formes d’actions mais toujours efficaces”.
Le voisin chinois, Taiwan, par exemple, avec une population de 23,6 millions d’habitants, n’a signalé que 195 cas de coronavirus et deux décès au 23 mars.
Hong Kong (7,5 millions d’habitants) partage une frontière terrestre avec la Chine, mais n’a signalé que 155 infections confirmées et quatre décès en plus de deux mois (bien que d’autres cas ont été signalés au cours de la semaine dernière et qu’un ensemble de nouvelles mesures ait été introduit).
Près du Japon (120 millions d’habitants) 1 100 infections ont été enregistrées, tandis que la Corée du Sud a signalé environ 9 000 patients, mais le taux d’infection et de décès a baissé ces dernières semaines.
Selon Nyenswah, ces pays ont réussi à gérer la propagation du coronavirus car ils ont agi rapidement et ont appliqué des politiques innovantes.
Voici les plus efficaces:
1. Effectuer des tests, encore des tests, est la première étape pour contenir la pandémie
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les experts consultés par la BBC conviennent que la détection précoce est un facteur fondamental pour contenir la propagation de la pandémie. “Vous ne pouvez pas connaître l’impact réel du virus ou prendre les mesures appropriées si vous ne savez pas combien de personnes sont touchées”, explique Nyenswah.
Krys Johnson, professeur d’épidémiologie à l’Université Temple (USA), partage le même avis.
Selon lui, c’est ce qui a fait une réelle différence pour contenir le virus: les pays qui se sont appuyés sur les tests ont vu le nombre de nouveaux cas chuter, tandis que les pays où les tests n’ont pas été mis en œuvre ont vu le nombre de cas augmenter fortement.
“La Corée du Sud a testé environ 10 000 personnes par jour, ce qui signifie qu’elles ont testé plus de personnes en deux jours que l’ensemble des États-Unis en plus d’un mois”, a-t-il déclaré à la BBC.
Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, déclare que le dépistage de toute personne présentant des symptômes est la “clé pour arrêter la propagation” de la pandémie.
“Nous avons un message simple à adresser à tous les pays - test, test, test”, a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse. “Tous les pays devraient pouvoir tester tous les cas suspects - ils ne peuvent pas lutter contre cette pandémie les yeux bandés”.
Il a également mis en garde contre le fait de ne tester que ceux présentant les symptômes les plus graves: les données obtenues ne seraient pas fiables pour les statistiques et la pratique encourage ceux qui présentent des symptômes plus légers à continuer de propager le virus.
2. Isoler les personnes infectéees et les cas suspects s’est avéré efficace contre la maladie
La Corée du Sud et la Chine ont fait un excellent travail de suivi, de test et de confinement de leurs citoyens”, explique le professeur Krys Johnson.
Les tests isolent non seulement les malades et empêchent le virus de se propager, mais aident à repérer de nouveaux cas potentiels qui pourraient être aux premiers stades (et donc asymptomatiques), dit-elle.
Selon Johnson, les autorités chinoises ont été “hypervigilantes” dans la détection de nouveaux cas potentiels, ce qui pourrait être l’une des causes de la baisse significative des infections signalées.
“Les personnes ayant une température élevée sont envoyées dans des« cliniques de fièvre »et testées pour la grippe ou Covid-19. S’ils sont positifs pour Covid-19, ils sont isolés dans ce qui a été surnommé “hôtels de quarantaine” pour éviter d’infecter leurs familles”, elle dit.
Taïwan, Singapour et Hong Kong ont adopté une approche différente: isoler les cas suspects chez eux et infliger des amendes de plus de 3 000 dollars à ceux qui enfreignent les règles. Mais dans les deux cas, selon Nyenswah, la clé de cette stratégie était de repérer et de suivre les infections potentielles.
Il dit qu’à Taiwan et à Singapour, il y avait des stratégies en place pour repérer les personnes qui avaient été en contact avec les malades - des interviews des personnes infectées à la vérification des caméras de sécurité ou des registres de transport.
“Le 12 mars, Hong Kong avait 445 cas suspects - mais elle a effectué 14 900 tests parmi toutes les personnes qui avaient été en contact avec ces personnes pour détecter d’éventuelles infections - 19 d’entre eux étaient positifs”, dit-il.
3. Désinfecter est également une bonne stratégie
Nyenswah, qui avait auparavant œuvré à la prévention de la propagation d’Ebola en Afrique de l’Ouest, affirme que l’un des éléments de base pour la maîtrise d’un virus est d’agir rapidement, avant que la contagion ne touche la population.
“Des pays comme Taïwan et Singapour ont montré qu’une action rapide de détection et d’isolement de nouveaux cas peut être un facteur décisif pour contenir la propagation”, dit-il.
Un récent article publié par le Journal de l’American Medical Association dit que le succès de Taïwan est également en partie dû au fait que l’île a été préparée par une telle éventualité et a créé un centre de commandement pour contrôler les épidémies dès 2003.
L’organisation -qui comprend plusieurs agences de recherche et gouvernementales- a été créée après la crise du SRAS et a depuis mené plusieurs exercices et études.
“Être prêt à agir et à le faire rapidement sont des éléments essentiels dans les premiers stades d’une épidémie. En Europe et aux États-Unis, nous avons vu que non seulement ces pays n’étaient pas prêts, mais ils tardaient également à réagir”, a déclaré Nyenswah.
Avant même que la transmission virale de personne à personne ne soit confirmée à la mi-janvier, Taiwan avait déjà commencé à filtrer tous les passagers en provenance de Wuhan, la ville chinoise où l’épidémie a commencé.
Hong Kong a commencé à mettre en place des stations de détection de la température à ses points d’entrée à partir du 3 janvier, suivies de quarantaines de 14 jours pour les touristes entrant sur son territoire, tandis que les médecins ont été invités à signaler tout patient présentant de la fièvre ou des symptômes respiratoires aigus et des antécédents de voyage récent vers la région de Wuhan.
“Encore une fois, le facteur temps a été déterminant”, explique Nyenswah.
4. Distanciation sociale : une distance de sécurité est recommandé
“Une fois que la maladie est déjà dans votre pays, les mesures de confinement ne sont plus valables”, explique Nyenswah. D’ici là, le moyen le plus efficace de protéger la population est de mettre rapidement en œuvre la distanciation sociale - comme cela a été démontré à Hong Kong et à Taiwan.
Hong Kong a dit aux gens de travailler à domicile, fermé les écoles et annulé tous les événements sociaux fin janvier.
Singapour a décidé de garder les écoles ouvertes, mais elle a effectué des tests et surveillé quotidiennement les étudiants et le personnel universitaire, selon le journal The Straits Times.
5. Promouvoir des mesures d’hygiène : se laver les mains avec du savon ou utiliser du gel antiseptique est fortement recommandé.
L’OMS affirme qu’un lavage régulier des mains et une bonne hygiène sont essentiels pour éviter la contagion.
“De nombreux pays asiatiques ont tiré des leçons de l’expérience du SRAS en 2003.
Ces nations savent que l’hygiène empêchera les gens de tomber malades et les empêchera d’infecter les autres”, explique Nyenswah.
Dans des pays comme Singapour, Hong Kong et Taïwan, il existe des stations avec un gel antibactérien dans les rues et l’utilisation régulière de masques faciaux est répandue.
Bien que les masques faciaux ne soient pas toujours efficaces pour empêcher le porteur d’attraper la maladie, ils réduisent le risque qu’ils la transmettent par la toux et les éternuements.
7. Coronavirus : comment sont comptés les morts dans le monde ?
Ssources : pour la vidéo qui suit gouvernement.fr, pour le texte communiqué AFP du 10 avril 2020
Le comptage quotidien des victimes du Covid-19, dont le nombre officiel dépasse les 100 000 morts au début d’avril 2020, est un exercice délicat, le recueil des données en temps réel n’étant que parcellaire et les méthodes variables selon les pays. AFP - 10 avr. 2020
Lieu du décès, façon d’identifier les causes de la mort, délais différents de remontée des informations : plusieurs éléments peuvent avoir de l’impact sur ces décomptes, forcément sous-évalués mais essentiels pour surveiller l’évolution de la pandémie. Il s’agit d’un vrai « défi statistique », souligne ainsi l’institut français des études démographiques, l’Ined.
Hôpitaux et maisons de retraite
Si l’Espagne et la Corée du Sud comptabilisent tous les décès de personnes testées positives au Covid-19, que ce soit à l’hôpital ou en-dehors, ce n’est pas le cas de tous les pays. Les chiffres iraniens, par exemple, ne semblent inclure que des décès à l’hôpital.
Jusqu’à récemment, les décès en maison de retraite ne figuraient pas non plus dans les chiffres officiels français et britanniques. Ils sont pourtant loin d’être marginaux, puisqu’ils représentent aujourd’hui plus du tiers du bilan en France.
Aux Etats-Unis, les décès pris en compte varient d’un Etat à l’autre : l’Etat de New York inclut les maisons de retraite, la Californie non.
Même en Italie, qui affiche officiellement le bilan le plus lourd dans le monde (plus de 18 000 morts au début d’avril 2020, les décès en maison de retraite ne sont pas tous recensés.
Covid-19 ou une autre maladie ?
Si certains pays, comme la Corée du Sud, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, incluent dans leurs chiffres toutes les personnes ayant été testées positives au coronavirus, même celles décédées des complications d’une maladie préexistante, d’autres pays sont plus sélectifs.
En Iran, sont exclus des bilans les patients testés positifs mais décédant d’une autre « maladie respiratoire grave ».
Aux Etats-Unis se multiplient des témoignages de personnes dont les proches sont morts, officiellement de pneumonie, avant que les tests ne soient disponibles ou à un moment où ils étaient difficiles à obtenir.
Manque de tests et délais
Pendant une épidémie, « la remontée et le traitement des informations, même accélérés, se font avec quelques jours de décalage et ne couvrent pas tous les décès. Il faut plusieurs semaines ou plusieurs mois pour pouvoir décompter précisément tous les morts », estiment Gilles Pison et France Meslé, démographes à l’Ined, sur le site The Conversation.
Aux Etats-Unis, même en l’absence de test, les certificats de décès doivent mentionner si le Covid-19 est la cause « probable » de la mort, mais ces certificats mettent du temps à remonter et ne peuvent être pris en compte pour les bilans en temps réel.
En Espagne, les registres d’état-civil et le nombre d’enterrements font apparaître une surmortalité bien supérieure à celle qui devrait découler du bilan officiel du Covid-19.
Par manque de tests, l’Espagne réalise très peu de dépistages post-mortem. Ainsi, si une personne n’a pas été dépistée avant de mourir, elle n’est pas comptabilisée par les autorités sanitaires. Les données judiciaires, moins restrictives, laissent entrevoir un bilan bien supérieur : par exemple, le tribunal supérieur de Castille-La Manche a enregistré en mars 1 921 actes de décès « dont la cause est due au Covid ou à une suspicion de Covid », soit près de trois fois plus que les 708 morts (positifs au Covid-19) recensés au 31 mars par les autorités sanitaires.
Autre illustration : à Bergame, en Lombardie, ont été recensés, au cours de la première quinzaine de mars, 108 morts de plus (+193%) qu’un an plus tôt… mais seulement 31 décès liés au Covid-19.
Chine et Iran accusées de mentir
Parfois, la sincérité même des chiffres publiés est remise en cause.
En Iran, les bilans officiels ont été contestés, notamment au début de l’épidémie, par des responsables provinciaux et des parlementaires. Même l’agence officielle Irna a parfois diffusé des chiffres plus élevés que ceux des autorités, bilans ensuite démentis par le gouvernement. A l’extérieur du pays, Washington, notamment, a reproché à Téhéran de maquiller ses chiffres.
Concernant la Chine, berceau de l’épidémie, un rapport confidentiel des renseignements américains, cité par l’agence Bloomberg, a accusé Pékin d’avoir intentionnellement sous-évalué son bilan. Ses chiffres ont également été mis en doute par plusieurs responsables iraniens, mais le porte-parole du ministère de la Santé a été contraint à corriger ses propos après avoir qualifié le bilan chinois de « plaisanterie de mauvais goût ».
8. Le confinement, bon pour la qualité de l’air
Sources : pour la vidéo qui suit gouvernement.fr, pour le texte Futura Sciences
Début 2020, le monde vit une crise sans précédent. Le coronavirus responsable d’une pandémie meurtrière de Covid-19 se répand. Dans l’espoir de limiter sa propagation, les populations sont confinées. Les économies, mises à l’arrêt. Avec pour effet collatéral, une baisse spectaculaire de la pollution de l’air extérieur.
Le ralentissement économique mondial a eu un impact important sur l’environnement
La pollution et l’effet de serre ont été réduits de manière drastique dans plusieurs régions du monde. Ce sont des résultats indirects, mais positifs de cette pandémie sans précédent. Les restrictions de l’activité économique, du trafic aérien, terrestre et maritime, ainsi que la fermeture d’industries et le confinement de la population ont permis une diminution surprenante de la pollution environnementale et des émissions de gaz à effet de serre.
Le ralentissement économique provoqué par la pandémie devrait avoir un impact équivalent ou supérieur à celui de la récession mondiale de 2008 sur les émissions. En d’autres termes, nous aurons une baisse absolue des émissions globales de carbone d’ici fin 2020 et peut-être même jusqu’en 2021 ou 2022. Grâce au confinement de la population, des animaux sauvages ont été observés dans certaines villes : un puma à Santiago du Chili, un sanglier dans les rues de Barcelone, ou encore une civette en Inde.
L’eau des canaux de Venise n’a jamais été si transparente que depuis le confinement.
Le premier pays à réduire son taux de pollution environnementale a été la Chine, le plus grand pollueur du monde et source de l’épidémie de coronavirus en décembre dernier. La concentration de dioxyde d’azote, l’un des polluants les plus fréquents dans les zones urbaines, a diminué de 30 à 50 % dans plusieurs villes chinoises importantes, par rapport à la même période en 2019.
Selon les experts, l’épidémie a paradoxalement épargné plus de vies que les décès qu’elle a provoqués. En Chine, 1,1 million de personnes en moyenne meurent chaque année, victimes de la pollution. Malgré ces signes de rétablissement de l’environnement, les chercheurs craignent que cette interruption ne soit de courte durée, surtout si une conscience globale ne surgit pas une fois la pandémie derrière nous.
Quels sont les effets négatifs du coronavirus sur la planète ?
La principale conséquence de la crise mondiale causée par l’épidémie est de faire passer les autres débats, dont l’urgence climatique, au second plan. La pandémie est temporaire, mais les effets du réchauffement climatique se feront sentir aujourd’hui et de plus en plus dans les siècles à venir. Le changement climatique reste un problème grave pour notre planète. La concentration des gaz à effet de serre déjà présents dans l’atmosphère suffit à elle seule à garantir une augmentation de la température moyenne de la Terre pendant plusieurs siècles.
Les experts prédisent que nous aurons davantage d’événements extrêmes dans le futur (séismes, inondations, tornades… etc.) avec des conséquences pour les infrastructures et la production alimentaire. Mais ces risques sont descendus sur l’échelle des priorités en cette période de pandémie.
Pourtant, au rythme où nous étions avant le frein malencontreux provoqué par cette crise, il y avait peu de chances de limiter la hausse de la température de 1,5 ou 2 degrés, le maximum considéré comme sûr pour éviter des tragédies climatiques majeures.
Alors, ce sujet mérite-t-il d’être laissé de côté ?
Nous avons maintenant le temps d’analyser les investissements en infrastructures qui nous emprisonnent dans une économie à forte intensité de gaz à effet de serre, puisque la plupart d’entre eux sont suspendus en raison de l’impact économique de la pandémie. Ainsi, c’est le bon moment pour travailler sur des mesures de sortie de crise, et de prévoir une transition vers des moyens de produire des biens, des services et de l’énergie avec un impact moindre sur le climat.
9. Coronavirus : le point sur les traitements et vaccins
Par Pauline Vallée, article publié le 18 Mai 2020 dans la revue We Demain
Les laboratoires se mobilisent pour fournir au plus vite des médicaments et vaccins afin d’enrayer l’épidémie de coronavirus. Plusieurs pistes sont prometteuses, mais il faudra encore attendre avant de valider définitivement les premiers traitements.
Aucun traitement ni vaccin n’a encore été mis au point contre le virus Covid-19, alors que le cap des 280 000 décès a été franchi dans le monde, dont plus de 25 000 en France. Mais la recherche s’organise et progresse. We Demain fait le point sur les dernières avancées médicales.
Du Côté des traitements
Rappelons d’abord que la maladie étant due à un virus, le coronavirus Sars-CoV2, et non une bactérie, les antibiotiques s’avèrent inefficaces (sauf pour prévenir une surinfection).
-
Le programme européen Discovery étudie depuis le 22 mars l’efficacité de 4 traitements expérimentaux contre le Covid-19, parmi lesquels l’hydroxychloroquine, le remdesivir, une combinaison lopinavir+ritonavir (Kaletra) et une combinaison Kaletra+interféron bêta. Alors que les premiers résultats devaient être communiqués la semaine dernière, l’étude accuse un certain retard. Un comité d’experts, réuni le 11 mai, a estimé qu’il fallait la poursuivre en incluant de nouveaux patients.
-
L’hydroxychloroquine a été intégrée dans plusieurs essais cliniques, dont l’étude Hycovid depuis le 31 mars et l’essai clinique “PrEP COVID” depuis le 14 avril. Une étude française et une étude chinoise, toutes deux publiées le 14 mai, indiquent que l’antipaludéen n’est pas plus efficace que les traitements standards contre le Covid-19.
-
Alors que des essais menés par l’Université de Chicago semblaient suggérer que le remdivisir, un antiviral expérimental développé par le laboratoire Gilead pour lutter contre le virus Ebola, permettrait de ralentir la progression du Covid-19, des études conduites en Chine se révèlent bien moins optimistes. Les États-Unis et le Japon ont néanmoins décidé d’autoriser la molécule pour traiter les patients.
-
Le tocilizumab, un anticorps déjà utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, serait efficace sur les malades atteints d’insuffisance respiratoire, d’après de premiers résultats relayés par l’AP-HP. Une série d’essais, commencée le 27 mars dernier, montre une amélioration du pronostic vital c hez les patients ayant reçu le traitement.
-
L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament a décidé, jeudi 30 avril, d’autoriser les transfusions de plasma – partie liquide du sang qui contient des anticorps – de patients guéris du Covid-19 à des malades. Des hôpitaux situés dans trois régions françaises (Ile-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) étudient l’efficacité de cette thérapie depuis début avril, dans le cadre de l’essai Coviplasm.
-
Un autre antibiotique, l’azithromycine, a intégré le 14 avril l’étude “PreEP COVID” afin de déterminer son potentiel préventif contre le Covid-19.
Du côté des vaccins
Solution de long terme contre la maladie, la création d’un vaccin nécessite un délai de plusieurs mois entre sa conception et sa mise sur le marché. Plus d’une centaine de candidats vaccins ont été recensés, dont seulement dix ont débuté leurs essais cliniques sur l’Homme.
Chaque vaccin fait l’objet de plusieurs essais cliniques avant d’être commercialisé. On distingue notamment trois grandes étapes de validation : 1. la première évalue la tolérance du candidat vaccin par des adultes en bonne santé, 2. la seconde détecte les effets secondaires optentiels ainsi que la réponse imunitaire das volontaires vaccinés, 3. la troisième évalue l’impact du candidat vaccin sur une population plus diversifiée (personnes âgées, fragiles, enfants…).
-
Les deux premiers essais européens sur l’homme ont eu lieu le 23 avril au Royaume-Uni et en Allemagne. Le vaccin ChAdOx1 développé par l’université d’Oxford sera testé sur 800 patients, rapporte la BBC. Le vaccin BNT162 mis au point par la société allemande BioNTech a également obtenu le feu vert pour être testé sur 200 volontaires.**
-
En Chine, quatre laboratoires (Sinovac, Shenzen Geno-Immune Medical Institute, Beijing Institute of Biological Products et CanSino Biologics) ont également débuté leurs premiers essais cliniques sur des volontaires.
-
Aux États-Unis, la phase II de l’essai du vaccin mRNA-1273 devrait débuter au deuxième trimestre 2020, a indiqué l’entreprise de biotechnologies américaine Moderna Therapeutics dans un comuniqué. Le vaccin candidat sera testé sur 600 patients pendant 12 mois. Si les premiers essais sont concluants, la phase III de l’essai pourrait commencer dès cet automne.
-
L’Australie et les Pays-Bas ont débuté leurs premiers essais cliniques afin de déterminer si un vaccin déjà existant, le vaccin contre la tuberculose (BCG), serait efficace pour combattre le virus, ou du moins atténuer les symptômes de la maladie. La France devrait prochainement commencer ses propres tests, sous la direction de Camille Locht, directeur de recherche Inserm à l’institut Pasteur de Lille.
10. Contribution de la Convention Citoyenne pour le Climat au plan de sortie de crise
Document publié le 10 Avril 2020
Qui nous sommes ?
Nous, citoyennes et citoyens, âgés de 16 à 80 ans, avons été tirés au sort pour être membres de la Convention Citoyenne pour le Climat. Beaucoup parmi nous ont des enfants et des petits enfants ; nous sommes soucieux, pour eux et pour les générations futures, de préparer un avenir meilleur et de laisser une planète habitable.
Notre travail des six derniers mois a porté sur l’urgence climatique et les moyens les plus appropriés d’y répondre, sans laisser personne au bord du chemin.
Nous sommes des citoyens, représentatifs d’une diversité de l’ensemble de la société. Indépendants du Gouvernement, nous avons veillé à l’être aussi de tous les groupes de pression quels qu’ils soient, tout en auditionnant certains d’entre eux dans un souci d’impartialité.
Nos points de vue se sont parfois opposés, mais nous avons su nous écouter et construire ensemble des propositions que nous estimons justes et équitables.
Pourquoi nous nous exprimons sur ce sujet ?
Alors que la remise définitive de nos travaux est différée par la crise sanitaire, et alors même que certains d’entre nous sont en première ligne, nous avons jugé important de nous exprimer dès aujourd’hui.
Nous nous exprimons, car la crise que nous traversons n’est apparemment pas sans lien avec le dérèglement climatique et la dégradation de l’environnement. De même que la maladie est une menace pour notre santé, le changement climatique est une menace pour notre planète et ses écosystèmes.
La perte de biodiversité, la destruction des milieux naturels, sont des témoins de la crise écologique, mais sont aussi pointés comme des facteurs importants de la crise sanitaire d’aujourd’hui.
La multiplication des échanges internationaux et nos modes de vie globalisés sont à l’origine de la propagation rapide de l’épidémie et peuvent aussi aggraver la crise climatique. Tous ces facteurs augmenteront encore demain les risques sanitaires et les inégalités sociales. La crise du Covid-19 nous interroge sur les effets d’une crise environnementale à venir. Il ne faudrait pas, avec les mesures qui seront prises pour sortir de la situation sanitaire actuelle, que nous accélérions le dérèglement climatique.
Nous nous exprimons, car il est urgent d’agir pour construire demain. Les évènements que nous vivons aujourd’hui remettent en cause nos manières de se nourrir, de se déplacer, de se loger, de travailler, de produire et de consommer.
Nos modes de vie sont bouleversés et nous interrogent sur nos priorités, nos besoins, et nos comportements quotidiens. Nous nous exprimons, car c’est notre devoir de citoyens de la Convention.
Même si la crise sanitaire est soudaine et que nous n’y étions pas préparés, il nous paraît crucial d’agir, d’apporter notre pierre à l’édifice et à la dynamique de sortie de crise. En effet, si nos travaux restent à voter et à finaliser, la Convention Citoyenne pour le Climat est déjà parvenue à structurer des propositions.
Face à l’urgence, certaines de nos mesures permettraient de contribuer à la fois à une relance économique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, indéniablement, à améliorer notre santé et notre bien-être collectifs, tout en tenant compte des populations les plus fragiles.
Sur la base de ces critères précis, la Convention Citoyenne pour le Climat a choisi de partager avec le Président de la République et le Gouvernement une partie de ses travaux (environ un tiers) dans leur état actuel d’avancement avec d’éventuels amendements ou réserves, avant transcription légistique, soit en version intégrale soit en version courte selon le choix des membres de la Convention.
Ces pistes n’ayant pas été votées formellement par la Convention qui doit encore poursuivre ses travaux, nous avons fait le choix de ne pas les partager en l’état avec la société française, dans l’attente d’un rapport final et complet qui sera rendu public.
Quels sont les messages que nous adressons aux dirigeants qui sont en train de préparer la stratégie de sortie de crise ?
Nous souhaitons que la sortie de crise qui s’organise sous l’impulsion des pouvoirs publics ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l’humain et de la biodiversité. Nous demandons de ne pas reproduire les erreurs passées.
Il faut absolument éviter les écueils de la crise de 2008 dont la relance a donné lieu, notamment, à des investissements dans les énergies fossiles et les industries néfastes à l’environnement.
La situation inédite que nous subissons aujourd’hui nous oblige à réfléchir, au contraire, à la manière de lier économie et environnement. En ce sens, le court terme ne doit pas prendre le pas sur le long terme : les décisions actuelles doivent s’inscrire dans une démarche durable et de justice sociale qui profitera à toutes et tous et pour longtemps, sans pénaliser les plus démunis.
Nous appelons nos décideurs à faire preuve de responsabilité politique et à assumer des choix courageux pour le futur.
La stratégie de sortie de crise, devra alors porter l’espoir d’un nouveau modèle de société ; celle-ci doit permettre de rompre avec les pratiques destructrices pour notre environnement, notre société et l’humanité. Ainsi, faudrait-il nous efforcer de poser les bases d’une société plus juste et plus pérenne en mettant en place les modes de vie que nous voulons pour demain.
Cette crise sanitaire ne doit pas nous précipiter dans une crise climatique dont les conséquences seraient également très graves. Même si la crise sanitaire est soudaine et que nous n’y étions pas préparés, il nous paraît crucial d’agir, d’apporter notre pierre à l’édifice et à la dynamique de sortie de crise.
En effet, si nos travaux restent à voter et à finaliser, la Convention Citoyenne pour le Climat est déjà parvenue à structurer des propositions. Face à l’urgence, certaines de nos mesures permettraient de contribuer à la fois à une relance économique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et, indéniablement, à améliorer notre santé et notre bien-être collectifs, tout en tenant compte des populations les plus fragiles.
Sur la base de ces critères précis, la Convention Citoyenne pour le Climat a choisi de partager avec le Président de la République et le Gouvernement une partie de ses travaux (environ un tiers) dans leur état actuel d’avancement avec d’éventuels amendements ou réserves, avant transcription légistique, soit en version intégrale soit en version courte selon le choix des membres de la Convention.
Ces pistes n’ayant pas été votées formellement par la Convention qui doit encore poursuivre ses travaux, nous avons fait le choix de ne pas les partager en l’état avec la société française, dans l’attente d’un rapport final et complet qui sera rendu public.
Nous voulons que la stratégie de sortie de crise nous prépare à l’avenir, c’est-à-dire à un modèle économique et sociétal différent, plus humain et plus résilient face aux futures crises, qu’elles soient sanitaires ou autre.
La situation actuelle, malgré son caractère catastrophique, souligne le besoin d’une transition de notre système industriel très émetteur de gaz à effet de serre et destructeur de la biodiversité vers un système plus vertueux et durable.
Expérience de sobriété poussée à l’extrême, le confinement a montré combien tout un chacun peut vivre de manière plus responsable et combien les Français sont réactifs face à l’urgence. Les décisions qui seront prises demain doivent s’inscrire dans une logique de développement durable.
Pour cela, nous préconisons que des grands travaux soient lancés pour réduire la dépendance de la France aux importations, favoriser l’emploi en France et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Alors que depuis plusieurs années les échanges marchands mondiaux croissent, la crise actuelle nous rappelle qu’il est nécessaire de relocaliser les activités des secteurs stratégiques pour assurer notre sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique.
Dans cette logique la France doit devenir un modèle écologique capable de créer une dynamique vertueuse à l’échelle internationale.
Nous demandons que les financements mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes et que les investissements se concentrent dans des secteurs d’avenir respectueux du climat.
Les plans de relance qui sont mis en place à la sortie des crises mobilisent des mécanismes de financements importants injectant des fonds considérables dans l’économie.
Nous devons donc veiller à ce que cet accroissement de l’investissement soit dirigé massivement dans la transition écologique et tienne compte de la situation des plus fragiles.
Nous avons conscience que cette transformation de notre modèle ne peut pas s’instaurer uniquement à l’échelle nationale. La reconfiguration des relations internationales doit se faire dans un esprit de justice sociale, et doit favoriser une régulation de la mondialisation en faveur du climat.
Face à la crise que nous traversons, il est nécessaire de réaffirmer l’importance des solidarités internationales pour une action efficace. Le risque de crispation et de repli national est déjà visible alors que chacun tente de lutter contre l’épidémie du Covid-19.
Dans ce contexte, il est d’autant plus nécessaire de fédérer autour de grands projets européens afin de diffuser un message positif et d’union. Le combat contre le changement climatique est un enjeu de taille qui nécessitera l’action et l’entraide de tous les Etats membres.
Enfin, cette crise nous concerne tous et ne sera résolue que grâce à un effort commun, impliquant les citoyens dans la préparation et la prise de décision.
La participation citoyenne est essentielle, nous le voyons tous les jours dans les nombreuses initiatives de solidarité qui germent partout en France pour que nous puissions continuer à vivre presque normalement. C’est le moment idéal d’écouter et de prendre en compte les remarques des citoyens pour la construction d’une société future.
11. Les arbres, une arme contre le réchauffement climatique
…selon une étude parue dans « Science ». Mais attention, si cela est absolument nécessaire, cela est complètement insuffisant sans toutes les autres actions à conduire pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre…
Par Nathan Mann, publié le 05 juillet 2019 dans le journal Le Monde
« Il y a de la place pour 0,9 milliard d’hectares de couvert arboré supplémentaires » sur Terre. Un chiffre astronomique – 14 fois la surface de la France – qui confirme que « la restauration des arbres fait partie des stratégies les plus efficaces pour atténuer le changement climatique ». C’est le constat d’un article publié le 4 juillet dans la revue Science, qui s’est attaché à calculer le potentiel global d’une reforestation massive de la Terre pour lutter contre le changement climatique.
Conduite par des chercheurs de l’Ecole polytechnique de Zurich, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Centre international de recherche agronomique pour le développement (Cirad), l’étude se veut encourageante. A la louche, ce serait « un peu plus de mille milliards d’arbres supplémentaires » qui pourraient être plantés, estime Jean-François Bastin, l’auteur principal de l’étude contacté par Le Monde.
Puits de carbone
De quoi maintenir 205 milliards de tonnes de carbone dans les branches, troncs et racines des nouveaux venus et en retirer autant de l’atmosphère. Les forêts stockent du carbone. Lors de leur pousse surtout, mais aussi une fois à maturité. Ce qui en fait un atout précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique, lui-même directement causé par la quantité de carbone présente dans l’atmosphère, principalement sous forme de CO2.
Le mécanisme est d’ailleurs reconnu par l’accord de Paris de 2015, qui incite les Etats à se soucier des « puits de carbone » et notamment des forêts. Ces puits seront d’ailleurs nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, si on en croit le rapport spécial du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) sur la question, paru fin 2018.
Depuis, les initiatives de reboisement se multiplient, comme par exemple le « défi de Bonn », institué en 2011 et qui se donne pour objectif de planter 350 millions d’hectares d’ici à 2030.
Où seraient ces nouvelles zones vertes ? En cataloguant les espaces pouvant accueillir des arbres, l’étude répond à cette question et permet de conclure que « la restauration des écosystèmes qui peuvent supporter des arbres est notre meilleure arme actuelle de lutte contre le changement climatique », selon Jean-François Bastin.
Canopée planétaire
En examinant près de 80 000 photos satellite d’espaces protégés pour « simuler un environnement le plus naturel possible où l’impact de l’être humain est minimal », les scientifiques ont d’abord « essayé d’estimer, à chaque endroit du monde, combien d’arbres pouvaient être supportés » en fonction des climats et des sols, raconte le scientifique.
« Nous avons ensuite extrapolé ce modèle au-delà des zones protégées », continue Jean-François Bastin. Une vision sans hommes « surréaliste », admet-il, mais permettant de servir de référence. L’étude ne cible d’ailleurs pas les hectares de forêts, mais la canopée planétaire, pour tenir compte des différences de densité entre forêts tropicales et zones arborées éparses.
Au total, sans la présence de l’homme, les arbres pourraient recouvrir 4,4 milliards d’hectares sur Terre au lieu des 2,8 actuels. En retranchant les zones agricoles et urbaines de la planète, ce seraient 900 millions d’hectares de canopée qu’il serait possible d’atteindre. La moitié dans six pays : Russie, Etats-Unis, Canada, Australie, Brésil et Chine.
Capter jusqu’à deux tiers du carbone émis par l’homme
Rétablir des forêts dans ces espaces permettrait de capter 205 milliards de tonnes de carbone – quantité impressionnante quand on sait qu’aujourd’hui, l’atmosphère contient autour de 300 milliards de tonnes de carbone émises par l’homme. Ce chiffre pourrait encore augmenter en comptant les arbres implantés en ville ou dans les champs, affirme Jean-François Bastin.
Il faudrait cependant agir vite, car le réchauffement climatique risque d’en réduire le potentiel, notamment entre les tropiques. En suivant les trajectoires actuelles, 223 millions d’hectares pourraient ne plus être boisés d’ici à 2050. Sans compter les hectares qui pourraient être détruits par l’homme d’ici là.
Surtout, « ce qu’affirme le rapport du GIEC (…), c’est que les émissions doivent diminuer maintenant, alors que les arbres mettent du temps à pousser », tempère la chercheuse en modélisation des écosystèmes Aude Valade (Université de Barcelone). « La seule chose que [la restauration des zones forestières] fait, c’est de nous acheter du temps, dix-huit ans à peu près », abonde Jean-François Bastin, tout en notant que les arbres poussent plus vite au début de leur vie. Un délai court, mais qui selon lui « peut être nécessaire pour changer les manières dont on vit sur la planète ».
Restaurer les forêts en fonction des contextes locaux
« Toutes les forêts n’ont pas la même valeur, ni en termes de carbone, et encore moins si on prend en compte les autres services écosystémiques », explique aussi Aude Valade. Alors que l’étude réalise une analyse globale et centrée sur le climat, elle rappelle qu’au niveau local, des questions de protection de la biodiversité, de lutte contre l’érosion, ou de purification de l’eau peuvent entrer en conflit avec les objectifs climatiques, et que certains programmes de reforestation peuvent être contre-productifs. Cas typique : la plantation massive d’eucalyptus au Portugal, qui propagent les incendies.
« Nous parlons de restauration des écosystèmes, il n’est absolument pas question de mettre des quantités incroyables d’eucalyptus en plein désert, indique Jean-François Bastin. Ce ne sont pas forcément des forêts mais des écosystèmes qui peuvent supporter des arbres, comme par exemple les savanes, qui en contiennent peu. » Il reconnaît que la question précise du type d’arbres à planter reste à déterminer localement, et que le choix devrait prendre en compte les changements climatiques futurs pour rester viable.
D’autant que la question de l’impact des arbres sur le climat reste débattue, et devrait intégrer les émissions de méthane et de composés organiques volatiles ainsi que la manière dont la couverture végétale peut modifier la réflexion de la lumière du soleil par les sols, donc le climat. Des éléments qu’il faut « évidemment prendre en compte quand on réfléchit à la possibilité de reforester », selon Jean-François Bastin, qui ajoute qu’aujourd’hui « les forêts sont encore mises en avant pour leur impact positif au niveau de la quantité de carbone que l’on retrouve dans l’atmosphère ».
12. Un avant-goût du choc climatique
PAR PHILIPPE DESCAMPS, journaliste au Monde diplomatique, ET THIERRY LEBEL, hydroclimatologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et à l’Institut des géosciences de l’environnement (IGE, Grenoble), contributeur aux travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
Mai 2020
En mars 2020, la crise sanitaire a relégué l’actualité climatique loin des titres. Pourtant, ce mois fera date comme le dixième de suite avec une température moyenne au-dessus des normales. « Une telle série de dix mois “chauds” consécutifs à l’échelle du pays est inédite », note Météo France, dont les données permettent de remonter jusqu’à 1900. L’hiver écoulé a battu tous les records avec des températures supérieures aux normales de 2 °C en décembre et janvier, puis de 3 °C en février. Pour se rassurer, on a préféré retenir l’amélioration spectaculaire de la transparence atmosphérique. Lueurs d’espoir : l’Himalaya redevenait visible à l’horizon des villes du nord de l’Inde, ou le mont Blanc depuis les plaines lyonnaises.
Nul doute que la mise à l’arrêt d’une bonne partie de la production entraînera cette année une baisse inégalée des émissions de gaz à effet de serre (GES) (1). Mais peut-on vraiment croire qu’une décrue historique va s’amorcer ? En révélant la vulnérabilité de notre civilisation, les fragilités associées au modèle de croissance économique mondialisée, du fait de l’hyperspécialisation et des flux incessants de personnes, de marchandises et de capitaux, le Covid-19 provoquera-t-il un électrochoc salutaire ? La crise économique et financière de 2008 généra, elle aussi, une baisse sensible des émissions, mais elles sont rapidement reparties à la hausse ensuite, battant de nouveaux records…
Signe avant-coureur de possibles effondrements plus graves, le naufrage sanitaire actuel peut se voir à la fois comme un modèle réduit et une expérience en accéléré du chaos climatique qui vient. Avant de devenir une affaire de santé, la multiplication des virus pathogènes renvoie aussi à une question écologique : l’emprise des activités humaines sur la nature (2). L’exploitation sans fin de nouvelles terres bouleverse l’équilibre du monde sauvage, tandis que la concentration animale dans les élevages favorise les épidémies.
Le virus a touché en premier lieu les pays les plus développés, car sa vitesse de propagation est étroitement liée aux réseaux d’échanges maritimes et surtout aériens, dont le développement constitue également l’un des vecteurs croissants des émissions de GES. La logique du court terme, de l’effacement des précautions montre, dans ces deux domaines, la capacité autodestructrice pour les humains de la primauté accordée au gain individuel, à l’avantage comparatif, à la compétition. Si certaines populations ou régions s’avèrent plus vulnérables que d’autres, la pandémie affecte progressivement la planète entière, de même que le réchauffement ne se cantonne pas aux pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone (CO2).
La coopération internationale devient alors capitale : freiner le virus ou les émissions de GES localement sera vain si le voisin ne fait pas de même.
Difficile de feindre l’ignorance devant l’accumulation des diagnostics. Grâce à la vivacité de la recherche en virologie ou en climatologie, la précision des informations disponibles ne cesse de s’affiner. Dans le cas du Covid-19, plusieurs spécialistes alertent depuis des années, notamment par la voix du professeur au Collège de France Philippe Sansonetti, qui présente l’émergence infectieuse comme un défi majeur du XXIe siècle. Des alarmes tangibles n’ont pas manqué : virus grippaux tels que H5N1 en 1997 ou H1N1 en 2009, coronavirus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-1) en 2003 puis le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) en 2012. De même, le rapport Charney, remis au Sénat américain il y a quarante ans, alertait déjà sur les conséquences climatiques potentielles de la hausse de la teneur de GES dans l’atmosphère. Les dispositifs multilatéraux pour le partage des connaissances et l’action en commun existent depuis une trentaine d’années, avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), puis la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC). Enfin, les scientifiques ne ménagent pas leur peine pour informer les décideurs et les sociétés face à la menace d’un réchauffement qui s’accélère.
Les scénarios de crise sont également connus. Très rapidement après l’apparition du Covid-19, plusieurs chercheurs et autorités sanitaires ont prévenu du danger d’une pandémie (3). L’ironie de la situation tient au fait qu’à la mi-avril 2020 les territoires les moins touchés sont les voisins immédiats de la Chine : Taïwan, six morts; Hongkong, quatre morts; Macao et Vietnam, zéro (4). Échaudés par l’épisode du SRAS en 2003 et conscients du risque épidémique, ils ont mis en œuvre sur-le-champ les mesures nécessaires pour le réduire : contrôles sanitaires aux entrées, dépistages en nombre, isolement des malades et quarantaine pour les potentiels contaminés, port du masque généralisé, etc.
En Europe, les gouvernements ont continué à gérer ce qu’ils considéraient comme leurs priorités : réforme des retraites en France, Brexit de l’autre côté de la Manche, crise politique quasi perpétuelle en Italie… Puis, ils ont promis pour les semaines à venir les actions ou les moyens qu’ils auraient dû mettre en œuvre des mois plus tôt! Cette incurie les a conduits à prendre des mesures beaucoup plus draconiennes que celles qui auraient pu suffire en temps voulu, non sans conséquences majeures sur le plan économique, social ou celui des libertés publiques. En repoussant toujours à demain le respect de leurs engagements pris en 2015 dans le cadre des accords de Paris sur le climat – ou en reniant la signature de leur pays, comme le président américain –, les mêmes États pensent gagner du temps. Ils en perdent !
Retards et rétroactions positives creusent notre dette environnementale
L’accélération soudaine qu’a connue la diffusion du virus en Europe avant le confinement devrait marquer les esprits. Les systèmes naturels n’évoluent que rarement de manière linéaire en réponse à des perturbations significatives. Dans ce genre de situation, il faut savoir détecter et prendre en compte les premiers signaux de déséquilibre avant d’être confrontéàdes emballements incontrôlables pouvant conduireàdes points de non-retour. Quand les soignants ou le personnel des établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) laissés sans protection et sans dépistage deviennent eux-mêmes porteurs du virus, cela crée des foyers de contamination en milieux hautement sensibles qui peuvent conduire à un effondrement des systèmes de santé, et impose un confinement généralisé. Semblablement, en matière climatique, effets retards et rétroactions positives – effets retours qui amplifient la cause de départ – creusent notre dette environnementale, à la manière d’un emprunteur impécunieux dont les nouveaux emprunts pour rembourser une dette ancienne seraient contractés à un taux toujours plus élevé. La baisse du couvert neigeux et la fonte des glaciers se traduisent ainsi par la disparition de surfaces réfléchissant naturellement le rayonnement solaire, créant les conditions d’une accélération des hausses de température dans les régions concernées, d’où une fonte encore renforcée alimentant d’elle-même le réchauffement. De même, la fonte du pergélisol arctique – qui couvre une superficie deux fois plus grande que celle de l’Europe – pourrait entraîner des émissions massives de méthane, un puissant GES qui intensifierait le réchauffement planétaire.
Une part grandissante de la population sent l’urgence à agir, confectionne ses propres masques, organise le secours aux plus âgés. Mais à quoi bon faire du vélo, composter ses déchets ou réduire sa consommation d’énergie quand le recours aux énergies fossiles est encore largement subventionné, quand leur extraction nourrit l’appareil de production et les chiffres de la « croissance » ? Comment sortir du phénomène itératif des crises amplifié par le discours politico-médiatique : négligence, émoi, effroi, puis oubli ?
Car il existe deux différences fondamentales entre le Covid-19 et le dérèglement climatique. L’une tient aux possibilités de régulation du choc subi, et l’autre à nos capacités à nous y adapter. L’autorégulation des épidémies par acquisition d’une immunité collective ne fait pas du Covid-19 une menace existentielle pour l’humanité, qui a déjà surmonté la peste, le choléra ou la grippe espagnole, dans des conditions sanitaires autrement difficiles. Avec un taux de létalité probablement inférieur à 1%–bien plus faible que d’autres infections –, le virus ne menace pas la population de la planète de disparition. En outre, même s’ils en ont négligé les prémices, les gouvernements disposent de connaissances et d’outils appropriés pour amoindrir le choc de cette autorégulation naturelle.
Relativement circonscrite, la crise du Covid-19 peut être comparée dans sa dynamique aux incendies qui ont embrasé la forêt australienne en 2019. Il y a un début et une fin, bien que celle-ci soit pour l’instant difficile à cerner et qu’un retour saisonnier de l’épidémie ne soit pas exclu. Les mesures prises pour s’y adapter sont relativement bien acceptées par la majorité de la population, tant qu’elles sont perçues comme temporaires.
À l’inverse, l’inaction en matière climatique nous fera sortir des mécanismes de régulation systémiques, conduisant à des dégâts majeurs et irréversibles. On peut s’attendre à une succession de chocs variés, de plus en plus forts et de plus en plus rapprochés : canicules, sécheresses, inondations, cyclones, maladies émergentes. La gestion de chacun de ces chocs s’apparentera à celle d’une crise sanitaire du type Covid-19, mais leur répétition nous fera entrer dans un univers où les répits deviendront insuffisants pour rebondir. De vastes régions abritant une grande partie de la population mondiale deviendront invivables ou n’existeront tout simplement plus, car elles seront envahies par la montée des eaux. C’est tout l’édifice de nos sociétés qui est menacé d’effondrement. L’accumulation des GES dans notre atmosphère est d’autant plus délétère que le CO2, le plus répandu d’entre eux, ne disparaîtra que très lentement, 40 % restant dans l’atmosphère après cent ans et 20 % après mille ans. Chaque journée perdue dans la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles rend ainsi plus coûteuse l’action à mener le lendemain. Chaque décision rejetée comme « difficile » aujourd’hui conduira à prendre des décisions encore plus « difficiles » demain, sans espoir de « guérison », et sans autre choix que de s’adapter vaille que vaille à un environnement nouveau, dont nous aurons du mal à maîtriser le fonctionnement.
Faut-il alors sombrer dans le désespoir en attendant l’apocalypse ? La crise du Covid-19 enseigne au contraire l’impérieuse utilité de l’action publique, mais aussi la nécessaire rupture avec la marche précédente. Après une accélération technologique et financière prédatrice, ce temps suspendu devient un moment de prise de conscience collective, de mise en question de notre mode de vie et de nos systèmes de pensée. Le virus SRAS-CoV-2 et la molécule de CO2 sont des objets nanométriques, invisibles au commun des mortels. Pourtant, leur existence et leur effet (pathogène dans un cas; créateur d’effet de serre dans l’autre) sont largement admis, tant par les décideurs que par les citoyens. En dépit de l’incohérence des préconisations gouvernementales, l’essentiel de la population a rapidement compris les enjeux et la nécessité de certaines mesures de précaution. La science représente dans ces temps un précieux guide pour la décision, à condition de ne pas devenir une religion échappant aux nécessités de la démonstration et de la contradiction. Et la rationalité doit plus que jamais conduire à écarter les intérêts particuliers.
Ne pas confondre la récession et la décroissance de nos productions insoutenables
Tous les pays disposent de réserves stratégiques de pétrole, mais pas de masques de protection… La crise sanitaire remet au premier plan la priorité qui doit être accordée aux moyens d’existence : alimentation, santé, logement, environnement, culture. Elle rappelle aussi la capacité du plus grand nombreàcomprendre ce quise passe parfois plus vite que les décideurs. Les premiers masques faits maison sont ainsi apparus quand la porte-parole du gouvernement, Mme Sibeth Ndiaye, jugeait encore leur port inutile… En revanche, nous semblons mieux armés pour réagir à des menaces concrètes immédiates que pour bâtir des stratégies permettant de parer à des risques plus lointains, aux effets encore peu perceptibles (5). D’où l’importance d’une organisation collective motivée par le seul intérêt général et d’une planification articulant les besoins .
Bien davantage encore que le Covid-19, le défi climatique conduit à remettre en cause notre système socio-économique. Comment rendre acceptable une évolution aussi radicale, un changement à la fois social et individuel ? Tout d’abord en ne confondant pas la récession actuelle – et délétère – avec la décroissance bénéfique de nos productions insoutenables : moins de produits exotiques, de passoires énergétiques, de camions, de voitures, d’assurances; plus de trains, de vélos, de paysans, d’infirmières, de chercheurs, de poètes, etc. Les conséquences concrètes de cette dernière ne deviendront acceptables par le plus grand nombre qu’en plaçant la justice sociale au rang des priorités et en favorisant l’autonomie des collectifs à tous les niveaux.
Un test très concret et rapide de la capacité des gouvernements à renverser les dogmes d’hier résidera dans leur attitude vis-à-vis du traité sur la charte de l’énergie. Entré en vigueur en 1998, en renégociation depuis novembre 2017, cet accord crée entre cinquante-trois pays un marché international «libre» de l’énergie. Visant à rassurer les investisseurs privés, il octroie à ces derniers la possibilité de poursuivre, devant des tribunaux arbitraux aux pouvoirs exorbitants, tout État qui pourrait prendre des décisions contraires à la protection de leurs intérêts, en décidant par exemple l’arrêt du nucléaire (Allemagne), un moratoire sur les forages en mer (Italie) ou la fermeture de centrales à charbon (Pays-Bas). Et ils ne s’en privent pas : à la fin mars, au moins 129 affaires de ce type ont fait l’objet d’un « règlement des différends» (6) – un record en matière de traités de libre-échange –, entraînant des condamnations pour les États d’un total de plus de 51 milliards de dollars (46 milliards d’euros) (7). En décembre, 278 syndicats et associations ont demandé à l’Union européenne de sortir de ce traité, qu’ils jugent incompatible avec la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat (8).
Au sortir de la crise sanitaire, les pays industrialisés auront moins besoin d’un plan de relance de l’économie d’hier que d’un plan de transformation vers une société dans laquelle chacun puisse vivre dignement, sans mettre en péril les écosystèmes. L’ampleur du recours indispensable à l’argent public – qui dépassera tout ce que l’on a pu connaître – offre une occasion unique : conditionner les soutiens et les investissements à leur compatibilité avec l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement.
(1) Kenneth Rapoza, « Japan ditches China in multi-billion dollar coronavirus shakeout », Forbes, New York, 9 avril 2020, www.forbes.com (2) Robert D. Atkinson, «The case for a national industrial strategy to counter China’s technological rise », Information Technology & Innovation Foundation, 13 avril 2020, www.itif.org (3) Cf. Pascal Marichalar, «Savoir et prévoir, première chronologie de l’émergence du Covid-19 », La vie des idées, 25 mars 2020, https://laviedesidees.fr (4) Site de l’université Johns Hopkins, 17 avril 2020, www.arcgis.com (5) Cf. Daniel Gilbert, « If only gay sex caused global warming », Los Angeles Times, 2 juillet 2006. (6) Site du traité sur la charte de l’énergie, www.energychartertreaty.org (7) «One treaty to rule them all », Corporate Europe Observatory - Transnational Institute, Bruxelles-Amsterdam, juin 2018. (8) «Lettre ouverte sur le traité sur la charte de l’énergie », 9 décembre 2019, www.collectifstoptafta.org
13. Les stratégies adoptées dans différents pays pour lutter contre le covid-19
Allemagne, Israël, Vietnam… Ce qui marche ailleurs contre le Covid-19
Deux millions de personnes contaminées, plus de 140 000 morts au 17 avril 2020… En peu de temps, le nouveau coronavirus s’est emparé de la planète entière. Chaque pays a choisi sa stratégie de défense selon ses moyens et sa culture. Tour du monde des méthodes mises en œuvre pour lutter contre le virus.
Par Ursula Gauthier
Publié le 17 avril 2020 dans le NouvelObs
Au commencement, il y a eu la mise sous cloche, tardive mais draconienne, de Wuhan, qui permit de mater l’épidémie, provisoirement, et au prix d’immenses souffrances infligées à la population. Et puis, non loin de là, il y a eu la r&action ultra-précoce mais inventive de Taïwan, qui a freiné l’avancée du fléau (393 cas et 6 morts) tout en autorisant la poursuite d’une activité normale. Entre ces deux extrêmes, la réponse des autorités à travers le monde a été extraordinairement multiple.
Derrière cette cacophonie, en réalité, seules trois voies sont possibles face à une épidémie :
-
La première, la stratégie de l’« élimination du virus », nécessite de l’avoir repéré dès son apparition et de se donner les moyens de le bloquer en remontant la filière de chaque transmission, en isolant chaque patient touché. Une poignée de pays peuvent se targuer de l’appliquer : Taïwan, déjà cité, le Vietnam, Singapour, la Corée du Sud malgré quelques ratés, la Nouvelle-Zélande, certains pays d’Europe de l’Est.
-
A l’opposé, il y a la stratégie de l’« immunisation collective », qui consiste au contraire à laisser courir le virus jusqu’à ce qu’une proportion suffisante de la population ait développé des anticorps. Stratégie cynique et terriblement coûteuse par les décès qu’elle inflige aux plus fragiles. La Grande-Bretagne, un temps tentée, a fait machine arrière, et la Suède pourrait suivre son exemple.
-
Entre ces deux extrêmes, on trouve l’infinie variété des stratégies d’« atténuation », qui visent avant tout, par des mesures de distance physique, d’hygiène, etc., à éviter un afflux trop massif de malades vers un système hospitalier peu préparé.
Les spécialistes discuteront longtemps des mérites comparés de ces trois voies. En pratique, cependant, le retard à stopper la flambée épidémique à Wuhan signifiait que le coronavirus était déjà sorti de sa boîte, qu’il circulait déjà sous de nombreuses latitudes, à une époque où pas un chef d’Etat ne savait encore qu’il aurait à se poser la question de la stratégie à adopter. Aujourd’hui, les mille ruisseaux de l’atténuation confluent peu à peu vers l’océan du confinement généralisé. Dans cette uniformisation forcée du destin humain, les sociétés continuent de réagir en fonction de leurs institutions, de leur mémoire ou de leurs traumatismes.
Mais la question qui se profile n’est plus seulement de savoir quel pays réussit le mieux à garder la tête hors de l’eau. Mais celle, encore plus difficile, de la façon dont les pays pauvres, placés devant un impossible choix – arrêter la contagion ou éviter une famine généralisée –, vont résister à la tragédie qui s’annonce.
Source pour les chiffres qui suivent : Université Johns-Hopkins, Baltimore, Maryland, Etats Unis
Attention, ces chiffres concernent des populations qui varient beaucoup d’un pays à l’autre, à titre d’exemple, en 2020, 330 millions aux Etats Unis, contre 0,36 million en Islande…
Si vous souhaitez consulter les chiffres à jour (ainsi que la situation dans tous les pays du monde) veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Afrique du Sud
Au 17 avril : 2 605 cas de coronavirus confirmés, 48 morts.
- Confinement
- Tests ciblés
Dès la fin de janvier, le pays a réactivé son dispositif de veille mis en place lors de l’épidémie d’Ebola. Pays africain le plus riche et le plus touché, l’Afrique du Sud, au système de santé défaillant, associe les secteurs hospitaliers public et privé. Une soixantaine de camionnettes se déploient dans les quartiers populaires. Le pays revendique 73 000 tests pour 57 millions d’habitants et souhaite en faire 30 000 par jour.
Allemagne
Au 17 avril : 137 698 cas de coronavirus confirmés, 4 052 morts.
- Confinement souple
- Dépistage précoce et massif (100 000 tests par jour)
Autriche
Au 17 avril : 14 476 cas de coronavirus confirmés, 410 morts.
- Confinement strict en phase d’assouplissement
- Dépistage systématique en cas de symptômes
Acheter des fleurs ou un livre, des gestes ordinaires rendus impossibles par un mois de confinement, sont à nouveau permis depuis mardi 14 avril en Autriche, un des premiers pays de l’Union européenne à avoir fermé ses frontières et mis sa population sous cloche dès la mi-mars, où la réouverture des petits commerces marque le retour progressif à un quotidien qui reste empreint de vigilance. Les autres magasins devraient suivre début mai, les restaurants mi-mai, avec des aménagements pour respecter les distances de précaution. Les déplacements restent limités à l’essentiel jusqu’à fin avril. Les écoles devraient rester fermées jusqu’à mi-mai, l’enseignement supérieur poursuivant les cours en ligne jusqu’à la fin de l’année universitaire.
Brésil
Au 17 avril : 30 683 cas de coronavirus confirmés, 1 947 morts.
- Confinement tardif et sporadique
- Tests réservés aux cas les plus graves
Côte d’Ivoire
Au 17 avril : 688 cas de coronavirus confirmés, 6 morts.
- Confinement à Abidjan et isolement des personnes fragiles
- Dépistage avec 45 centres de prélèvements de proximité
- Masque obligatoire à Abidjan, recommandé dans le reste du pays
Encore peu touchés, les Ivoiriens associent différentes stratégies : couvre-feu, centres de dépistage, confinement des personnes fragiles, télétravail. Les habitants se sont lancés très tôt dans la fabrication de « cache-nez », des masques lavables et réutilisables.
Danemark
Au 17 avril : 7 074 cas de coronavirus confirmés, 321 morts.
- Déconfinement très progressif
- Dépistage assez large
- Faible recours aux masques
Les écoles ont timidement rouvert mercredi 15 avril au Danemark après un mois de fermeture en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus. Le royaume scandinave est le premier pays européen à rouvrir ses crèches, écoles maternelles et primaires après l’instauration de restrictions le 12 mars pour endiguer l’épidémie. Les établissements du secondaire suivront le 10 mai. Les bars, restaurants, centres commerciaux, coiffeurs et salons de massages restent clos. Aucun rassemblement de plus de 10 personnes n’est autorisé. Les frontières demeurent fermées, les voyages à l’étranger déconseillés.
Etats-Unis
Au 17 avril : 671 331 cas de coronavirus confirmés, 33 284 morts.
- Confinement variable selon les Etats
- Mise en place du dépistage tardif
France
Au 17 avril : 147 091 cas de coronavirus confirmés, 17 941 morts.
- Confinement
- Tests très limités
Manque de tests, de masques, de lits de réanimation… La France, qui a dû gérer la pénurie, a adopté le 17 mars un confinement strict assorti d’amendes. Pas d’assouplissement prévu avant le 11 mai.
Islande
Au 17 avril : 1 739 cas de coronavirus confirmés, 8 morts.
- Non-confinement
- Tests systématiques
L’Islande a choisi d’être proactive en matière sanitaire et souple en matière économique. 1 000 personnes sont dépistées chaque jour, 6 % des 364 000 habitants ont déjà été testés. Dispositif inédit, qui ne vise pas les seuls malades mais tous les volontaires. Une distanciation de 2 mètres est exigée, mais seules les écoles maternelles et primaires sont fermées. Pas de confinement strict, frontières ouvertes, et touristes accueillis dans les commerces et restaurants.
Israël
Au 17 avril : 12 758 cas de coronavirus confirmés, 142 morts.
- Confinement strict et précoce
- Dépistage ciblé
Maroc
Au 17 avril : 2 283 cas de coronavirus confirmés, 130 morts.
- Confinement strict
- Dépistage massif
Désinfection des commerces, masque obligatoire, confinement strict… Le Maroc a également autorisé l’usage de la chloroquine à l’hôpital et réquisitionné tous les stocks du pays. L’industrie textile s’est reconvertie pour fabriquer des masques. Avec 5 millions de pièces produites par jour, le pays serait autosuffisant et bientôt en mesure d’exporter sa production en Europe.
Nouvelle-Zélande
Au 17 avril : 1 409 cas de coronavirus confirmés, 11 morts.
- Confinement radical
- Dépistage massif
Des mesures très fortes adoptées très vite ont porté leurs fruits. Une politique de dépistage systématique, avec création de dizaines de laboratoires ad hoc, fermeture des frontières aux étrangers, quatorzaine obligatoire pour ceux qui rentrent au pays, barrages routiers pour vérifier les déplacements inutiles… Le 9 avril, la Première ministre estimait « la chaîne de transmission, rompue », sans lever pour autant le confinement. Et, le 15 avril, Jacinda Ardern a fait une annonce forte : au cours des six prochains mois, les membres de son gouvernement et elle-même vont baisser leur salaire de 20 % par solidarité avec leurs compatriotes touchés de plein fouet par les répercussions économiques de l’épidémie.
Portugal
Au 17 avril : 18 841 cas de coronavirus confirmés, 629 morts.
- Confinement sans sanctions
- Tests limités
En état d’urgence depuis la mi-mars, le Portugal a décidé de confiner sans sanctions, ni attestation de déplacement. Cette autodiscipline porte pour l’instant ses fruits. Par rapport à l’Espagne – totalement confinée –, le pays reste relativement épargné (435 décès au 10 avril, contre 16 000 en Espagne), sans doute aussi grâce à sa position géographique. Profitant des leçons des pays voisins, le Portugal a également très rapidement fermé ses frontières.
Royaume-Uni
Au 17 avril : 104 147 cas de coronavirus confirmés, 13 759 morts.
- Confinement tardif
- 10 000 tests réalisés par jour (objectif 25 000)
Russie
Au 17 avril : 27 938 cas de coronavirus confirmés, 232 morts.
- Confinement tardif
- Dépistage à la demande
La fermeture de la frontière avec la Chine à la fin janvier et la limitation des voyages en provenance d’Europe n’ont pas suffi. Après des semaines de déni, la Russie a fini par adopter à son tour, le 10 avril, des mesures de confinement strictes. L’épidémie n’est plus cantonnée à Moscou, où les hôpitaux sont au bord de l’implosion. La plupart des entreprises ont suspendu leur activité, à l’exception des structures médicales, d’alimentation, de transport public et de défense. Les tests sont en revanche accessibles à tous, pour 23 euros. Début avril, 900 000 personnes (sur 140 millions d’habitants) avaient été dépistées.
Singapour
Au 17 avril : 4 427 cas de coronavirus confirmés, 10 morts.
- Confinement strict
- Tests limités pour l’instant
- Masque recommandé
Une stratégie « mesurée » mais efficace – fermeture des frontières, quarantaine des cas repérés et traçage rigoureux de leurs contacts – avait permis le maintien d’une vie normale. Mais le retour des nationaux de l’étranger entraîne une recrudescence telle qu’un confinement sévère a été institué le 7 avril : fermeture des boutiques, restaurants, écoles, rares sorties autorisées. Toute rencontre avec une personne extérieure au foyer est punie de six mois de prison.
Suède
Au 17 avril : 12 540 cas de coronavirus confirmés, 1 333 morts.
- Non-confinement
- Tests limités (effectués uniquement sur des personnes présentant des symptômes graves) C’est l’exception européenne. La Suède a choisi la responsabilisation individuelle plutôt que la contrainte. Seules les personnes à risque sont invitées à rester à la maison. Bars, écoles et collèges restent ouverts. Les voyages sont simplement « déconseillés » ; le télétravail, « encouragé ». Mais le pays pourrait être amené à devenir plus coercitif si le nombre de morts, qui s’est envolé au début d’avril, continuait à progresser.
Vietnam
Au 17 avril : 268 cas de coronavirus confirmés, 0 mort.
- Quarantaines massives
- Peu de tests
- Port du masque systématique
- Traçage des cas contacts
14. Alain Supiot : « Seul le choc avec le réel peut réveiller d’un sommeil dogmatique »
21/03/2020 Entretien avec Alternatives Economiques
ALain Supiot est juriste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « Etat social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ». Auteur de très nombreux ouvrages, L’esprit de Philadelphie, La gouvernance par les nombres, Le travail n’est pas une marchandise ou La force d’une idée pour ne citer qu’eux, revient pour Alternatives Economiques sur les croyances et le programme qui ont conduit au démantèlement méthodique des piliers de l’Etat social, dont on redécouvre soudainement l’utilité à la faveur de la crise sanitaire. Ce grand spécialiste du droit du travail, fondateur de l’Institut d’études avancées de Nantes, nous livre son analyse où il oppose la globalisation actuelle versus une mondialisation nécessaire ou encore une nécessaire réhabilitation du sens et du contenu du travail concernant l’emploi salarié (ndlr de l’A-P-S-N-)
AE : La pandémie de coronavirus jette une lumière crue sur la fragilité du système de santé et des soignants après des décennies de coupes budgétaires. Ironie de l’histoire, Emmanuel Macron renie sa propre politique et croyances affichées dans le marché, dans son discours du 12 mars. Quelle est votre analyse ?
AS : Pour ma part, je ne parlerais pas de reniement, mais plutôt de choc de réalité. C’est la foi en un monde gérable comme une entreprise qui se cogne aujourd’hui brutalement à la réalité de risques incalculables. Ce choc de réalité n’est pas le premier. Déjà en 2008, la croyance en la toute-puissance des calculs de risques s’était heurtée à la réalité des opérations financières, qui reposent toujours en dernière instance sur la confiance accordée à des personnes singulières. On ne renverse pas impunément l’ordre institutionnel, qui place le plan des calculs d’utilité sous l’égide d’une instance en charge de la part d’incalculable de la vie humaine.
Depuis les temps modernes, c’est l’Etat qui occupe cette position verticale et est garant de cette part d’incalculable, qu’il s’agisse de l’identité et la sécurité des personnes, de la succession des générations ou de la préservation de la paix civile et des milieux vitaux. Cette garantie est indispensable pour que puisse se déployer librement le plan horizontal des échanges entre les individus, et notamment les échanges marchands.
Or, c’est le renversement de cet ordre juridique et institutionnel qui caractérise la pensée néolibérale. Reposant sur la foi en un « ordre spontané du marché », appelé à régir à l’échelle du globe, ce que Friedrich Hayek a nommé la « Grande société », le néolibéralisme place le droit et l’Etat eux-mêmes sous l’égide des calculs d’utilité économique, et promeut ainsi un monde plat, purgé de toute verticalité institutionnelle et de toute solidarité organisée.
Nouvel avatar des expériences totalitaires du XXe siècle, la globalisation est un processus d’avènement d’un Marché total, qui réduit l’humanité à une poussière de particules contractantes mues par leur seul intérêt individuel, et les Etats à des instruments de mise en œuvre des « lois naturelles » révélées par la science économique, au premier rang desquelles l’appropriation privative de la terre et de ses ressources.
La dimension religieuse de cette croyance a été très tôt aperçue par Karl Polanyi, observant dès 1944 que « le processus que le mobile du gain a mis en branle ne peut se comparer pour ses effets qu’à la plus violente des explosions de ferveur religieuse qu’ait connue l’histoire ». Le propre de la ferveur religieuse est d’être imperméable aux critiques, aussi modérées et rationnelles soient-elles. Seul le choc avec le réel peut réveiller d’un sommeil dogmatique.
AE : Pourquoi ce choc ne s’est-il pas produit en 2008 ?
AS : La crise financière de 2008 aurait dû sonner ce réveil du songe néolibéral. Mais elle a très vite été retournée en un argument pour « passer à la vitesse supérieure ». Ce mot d’ordre fut celui de l’OCDE, intimant en 2010 de ne pas remettre en cause « les principes prônés depuis de longues années », mais bien au contraire d’intensifier les politiques visant à flexibiliser les marchés du travail, à « réaliser des gains d’efficience sur les dépenses, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, et d’éviter d’alourdir sensiblement les impôts ».
On s’est donc rendormi, mais d’un sommeil de plus en plus agité par l’évidence du caractère écologiquement et socialement insoutenable de la globalisation, par la migration de masses humaines chassées de chez elles par la misère, par la colère sourde des populations contre la montée des inégalités et la dégradation de leurs conditions de vie et de travail, colère éclatant à l’occasion en révoltes anomiques du type de celle des gilets jaunes. Ces tensions n’ont pas suffi à remettre en cause le programme néolibéral de démantèlement de l’Etat social. La rhétorique schizophrène du type « en même temps » ne suffisant pas à les calmer, elles nourrissent, partout dans le monde, la montée d’un néofascisme, fait d’ethno-nationalisme et d’obsessions identitaires, souvent pimenté de déni écologique.
Aujourd’hui comme en 2008, nous nous trouvons confrontés à des risques incalculables, qu’aucune compagnie d’assurances ne saurait garantir. Et aujourd’hui comme en 2008, comme dans toutes les crises majeures, on se tourne vers l’Etat pour les assumer. L’Etat, dont on attend qu’il use de tous les mécanismes de solidarité institués dans l’après-guerre – les services publics, la sécurité sociale, la protection des salariés – et si possible qu’il en invente de nouveaux.
On ne peut donc que se réjouir de voir le président de la République prendre conscience, je le cite : « Que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre Etat-providence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. » On ne peut que souscrire à son affirmation, selon laquelle une nation démocratique repose sur « des femmes et des hommes capables de placer l’intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs : la solidarité, la fraternité ». On ne peut que saluer son hommage à « ces milliers de femmes et d’hommes admirables qui n’ont d’autre boussole que le soin, d’autre préoccupation que l’humain, notre bien-être, notre vie, tout simplement ». Hommage d’autant plus méritoire que tous ceux-là ne rêvent pas de devenir millionnaires et n’ont aucune place dans l’échafaudage mental du système actuel.
AE : Face au mouvement à l’œuvre de démantèlement de l’Etat social, quel est le devenir de la justice sociale et d’un travail non aliénant face au « marché total » ?
AS : L’Etat social, dont on redécouvre les vertus à la faveur de l’épidémie actuelle, repose sur trois piliers qui ont en effet été méthodiquement sapés par les quarantes dernières années de politiques économiques (1).
Le premier de ces piliers est le droit du travail, né au XIXe siècle avec les premières lois visant, déjà, à faire face aux effets mortifères de l’essor du capitalisme industriel sur la santé physique des populations européennes. L’exploitation sans limite du travail humain finissait par menacer les ressources physiques de la nation, justifiant l’intervention du législateur pour limiter la durée du travail des enfants, en France par la loi du 22 mars 1841, puis des femmes avec la loi du 2 novembre 1892. Dès ces premières lois, le droit du travail, en insérant un statut protecteur dans tout contrat de travail, obligeait ainsi à prendre en considération, au-delà du temps court des échanges sur le marché du travail, le temps long de la vie humaine et de la succession des générations.
Le deuxième pilier est la Sécurité sociale, dont l’invention a répondu à la même nécessité de protéger la vie humaine des effets délétères de sa soumission à la sphère marchande. La première pierre en fut l’adoption dans tous les pays industriels de lois (en France celle de 1898) assurant la réparation des accidents du travail. En rendant les entreprises responsables des dommages engendrés par leur activité économique, ces lois ont ouvert la voie à l’idée de solidarité face aux risques de l’existence. Cette idée n’a cessé de s’affirmer par la suite, donnant naissance aux premières assurances sociales, puis à l’invention de la Sécurité sociale. Aux termes (toujours en vigueur) du premier article du Code de la sécurité sociale, celle-ci « est fondée sur le principe de solidarité nationale », ce qui la distingue aussi bien de la charité publique (aide ou protection sociale) que des assurances privées. Héritage de la tradition mutuelliste, la marque propre du modèle français de sécurité sociale établi en 1945, a été son autonomie vis-à-vis de l’Etat, qui en est le garant et non pas le gérant.
Enfin, le troisième pilier de l’Etat social est la notion de service public, selon laquelle un certain nombre de biens et de services, santé, enseignement, poste, énergie, transports… doivent être mis à disposition de l’ensemble des citoyens dans des conditions d’égalité, de continuité et d’accessibilité.
AE : Quelle est leur base juridique constitutionnelle ?
AS : En France, ces piliers ont été dotés d’une base juridique constitutionnelle à la fin de la Seconde Guerre mondiale et c’est pourquoi, contrairement par exemple aux réformes du New Deal américain, aucun d’eux n’a pu à ce jour être renversé (2). Mais conformément au mot d’ordre appelant à « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance », chacun d’eux a fait l’objet d’un travail de sape, qui s’est beaucoup accéléré sous la présidence d’Emmanuel Macron.
Le droit du travail a été affaibli à la fois dans sa structure, par le recul de l’ordre public social au profit de la négociation d’entreprise, et dans son périmètre, par « l’ubérisation » à laquelle la Cour de cassation vient de mettre un salutaire coup d’arrêt, qui vise à en réduire le champ d’application. Il en est allé de même des services publics, dont on a réduit le périmètre par la privatisation ou la mise en concurrence de nombre d’entre eux et dont on a affaibli la structure en prétendant les gérer « comme des entreprises » et les piloter par indicateurs, avec les effets dévastateurs que l’on sait, de désertification de la France dite périphérique ou de détraquement de l’hôpital public.
Ce double mouvement est aussi à l’œuvre en matière de sécurité sociale. L’échec à la fin des années 1990 de projets visant à ouvrir aux assurances privées et aux fonds de pension le « marché » très lucratif de la couverture des risques santé et vieillesse a conduit à adopter ce que Didier Tabuteau a nommé la « technique du salami ». C’est-à-dire la privatisation en fines tranches de ses parties les plus lucratives, tels que le « petit risque » en matière de santé, ou la couverture des risques chômage, famille et aujourd’hui vieillesse pour les titulaires des revenus les plus élevés. Cette réduction de périmètre s’est aussi conjuguée à une réforme de structure, moins souvent observée, consistant en une étatisation de la Sécurité sociale, et d’abord de ses ressources, dont le gouvernement dispose désormais comme bon lui semble, en lui faisant supporter les allègements de charge qu’il décide à des fins politiques.
AE : Quel est le poids du droit européen dans ce démantèlement ?
AS : Le droit européen est devenu un instrument de mise en conformité des législations nationales aux doctrines néolibérales, qui voient dans l’Etat social, non pas une condition de bon fonctionnement, mais au contraire une entrave à l’ordre du marché et aux libertés économiques. Ainsi que l’a observé Fritz Scharpf dès la fin du XXe siècle, le droit de l’Union est ainsi capable d’éroder les systèmes de solidarité édifiés démocratiquement au plan national, mais incapable de leur substituer des solidarités européennes. Les réponses purement nationales à l’actuelle pandémie sont une manifestation de plus de cette incapacité, déjà évidente lors des crises financières, monétaires et migratoires qui ont émaillé ces dix dernières années. La seule solidarité qu’ait réussi à organiser l’Union européenne est celle des contribuables pour sauver les banques de la faillite.
Loin de l’Europe des patries voulue par De Gaulle, ou de l’union politique que Jean Monnet et Robert Schuman pensaient pouvoir instaurer par le détour du Marché commun, l’Union européenne a réalisé le rêve néolibéral décrit dès 1939 par Friedrich Hayek, d’une fédération d’Etats capable de faire régner la concurrence libre et non faussée, car placée à l’abri des revendications démocratiques de justice sociale et de solidarité. On peut douter toutefois de la viabilité à long terme de cette créature institutionnelle sans tête politique et sans base démocratique.
AE : Vous écrivez que l’on est passé d’un régime de droit à un régime de « gouvernance par les nombres » (3). De quelle façon ?
AS : Selon le libéralisme classique, les forces du marché s’exercent dans des cadres constitutionnels et juridiques nationaux, qui les canalisent et les domestiquent. Le néolibéralisme a ceci de nouveau qu’il place le droit lui-même sous l’égide de calculs d’utilité économiques. Tel est l’objet de la théorie Law and Economics, aujourd’hui professée dans les meilleures universités américaines et européennes, et dont le père Richard Posner a pu logiquement affirmer que « si les enjeux sont assez élevés, il est permis de torturer ». En effet, si tout est affaire de calcul d’utilité et de proportionnalité, aucun principe juridique n’est intangible, pas même celui d’égale dignité des êtres humains. Après avoir été propagée dans les universités les plus prestigieuses, cette théorie a été largement mise en œuvre par la Cour de justice de l’Union européenne et a influencé la jurisprudence de nos plus hautes juridictions.
Cette soumission de la loi aux calculs d’utilité éclaire une autre différence importante du néolibéralisme par rapport au libéralisme qui consiste, non à interdire, mais à privatiser certains systèmes de mutualisation édifiés par l’Etat social. Telle a été par exemple la feuille de route adressée par la Banque mondiale aux Etats en matière de retraites. Dans son rapport de 1994, intitulé « Averting the old age crisis », elle les a incités à réduire, d’une part, les retraites par répartition au profit des retraites par capitalisation et, d’autre part, les pensions à prestations définies au profit de pensions à cotisations définies
Ce double mouvement devait permettre, et il a permis dans les pays qui ont suivi ces consignes, une montée en puissance des fonds de pension qui sont devenus des acteurs majeurs des marchés financiers, avec pour les retraités les conséquences catastrophiques que l’on sait lorsque, comme aujourd’hui, les cours de Bourse s’effondrent. En France, la loi Thomas, adoptée en 1997, fut une première tentative de mise en œuvre de ces directives de la Banque mondiale. Ce fut un échec en raison de l’attachement de la population au système hérité de 1945. D’où la nouvelle tentative du gouvernement actuel et les oppositions qu’elle suscite de la part de salariés, dont cette réforme ignore la diversité de leurs conditions de travail et qu’elle prive de toute certitude sur le montant futur de leurs pensions.
AE : Face à l’urgence démocratique, quelle est la capacité de résistance de la forme juridique ?
AS : Vous avez raison de parler de résistance. La constitutionnalisation des droits sociaux a permis de maintenir en France un Etat social, qui a été facilement balayé dans les pays où il n’avait pas de base juridique solide. Le droit joue alors comme une ancre flottante, qui peut freiner sans les empêcher les changements de cap politique. Mais sa fonction n’est pas seulement passive, car il a aussi une force d’entraînement. C’est ce que montre justement l’adoption en 1946 du préambule de la Constitution, qui a été le fruit des réflexions engagées dans la Résistance.
Proclamer l’égalité des hommes et des femmes, la participation des travailleurs à la gestion des entreprises ou la protection de la santé n’était pas en retard, mais bien plutôt en avance sur les faits, et le demeure. Dans des moments de péril, du type de ceux que nous traversons, il y a et il y aura toujours des hommes et des femmes qui, au lieu de se croire les jouets de forces immanentes, s’interrogeront, à la lumière des expériences historiques, sur les causes de leurs maux et sur le monde qu’ils veulent bâtir ensemble. Et la réponse à cette question prend nécessairement la forme juridique d’un monde tel qu’il devrait être.
De ce point de vue, le mythe d’une croissance indéfinie, qui a nourri l’Etat social, a émoussé notre capacité de poser ces questions essentielles. Depuis le New Deal et les Trente Glorieuses, on a cru qu’une augmentation continue des richesses permettait de faire l’économie de la question de la justice, à un moment et dans une société historique donnée. C’est l’une des ambivalences de la quatrième liberté proclamée par Roosevelt, le Freedom from want, qui dans la perspective keynésienne pouvait s’entendre à la fois comme libération du besoin et libération de la demande sur les marchés.
L’Etat social a ainsi transposé au niveau collectif la structure de l’emploi salarié : « Tu te soumets, mais en contrepartie je te promets un enrichissement et des conditions matérielles qui vont s’améliorer. » La question du sens et du contenu du travail a ainsi été évincée au profit des seules considérations de rendement et d’efficacité à court terme. Or cette éviction n’est plus tenable face à la montée des périls écologiques et sanitaires, qui sont du reste étroitement liés (4).
Nous sommes toujours sur cette pente lourde d’un pilotage des sociétés à partir d’indicateurs économiques, lesquels sont de plus en plus déconnectés des réalités vécues par les gens, qui prennent conscience du caractère insoutenable de ce modèle de croissance. D’où cette schizophrénie latente du discours politique, dont le « en même temps » est en France le symptôme : « Si vous voulez du travail, il y en a à 200 kilomètres d’ici, mais surtout ne dépensez pas de gasoil ! » A l’échelle internationale, le système multilatéral est frappé de la même schizophrénie, dont témoigne l’oxymore d’un « développement durable », décliné sous forme de batterie d’objectifs et d’indicateurs qui visent à gérer la planète comme une entreprise.
AE : Quelles sources d’espoir voyez-vous ?
AS : La crise sanitaire sans précédent que nous traversons peut conduire au meilleur comme au pire. Le pire ce serait qu’elle nourrisse les tendances déjà lourdes aux repliements identitaires et conduise à transporter à l’échelon collectif des nations, ou des appartenances communautaires, la guerre de tous contre tous que le néolibéralisme a promue à l’échelon individuel. Le meilleur ce serait que cette crise ouvre, à rebours de la globalisation, la voie d’une véritable mondialisation, c’est-à-dire au sens étymologique de ce mot : à un monde humainement vivable, qui tienne compte de l’interdépendance des nations, tout en étant respectueux de leur souveraineté et de leur diversité (5).
Ainsi entendue, la mondialisation est un chemin qui reste à tracer entre les impasses de la globalisation néolibérale et celles d’un repli sur soi, que l’interdépendance technologique et écologique des peuples rend illusoire. Cette perspective de la mondialisation correspond à ce que dans un texte de 1920, récemment exhumé par Bernard Stiegler, Marcel Mauss a nommé « l’internation » (6). La diversité des nations, des langues et des cultures n’est pas un obstacle, mais bien au contraire le premier atout dont dispose l’espèce humaine à l’heure de l’anthropocène.
Mais cet atout suppose, pour être joué, l’établissement d’une certaine solidarité entre les nations. Telle devrait être le rôle d’une Union européenne repensée et refondée. Telle était la mission assignée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale à des institutions telles que l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Unesco ou l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Marginalisées par les organisations économiques – Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale ou Organisation mondiale du commerce (OMC) –, elles mériteraient elles aussi d’être profondément réformées et armées juridiquement pour être à la hauteur de leur mission.
Mais il faut bien admettre que cet espoir est suspendu à la capacité des « élites » politiques, économiques et intellectuelles de se remettre en question, de faire retour sur elles-mêmes lorsqu’elles ont engagé leurs semblables dans une voie qui se révèle mortifère. Or cette capacité ne se manifeste guère que face à la catastrophe.
Puisque l’heure est aux lectures à la maison, je conseillerai donc celle de La grande implosion, conte philosophique publié par Pierre Thuillier en 1995. Il nous transporte après l’effondrement de l’ordre mondial, survenu à une date et pour une cause indéterminée, peut-être était-ce une pandémie ? Une commission d’enquête est nommée avec mission de comprendre pourquoi, alors que tout avait été dit et prédit sur les impasses de la course folle où l’Occident avait engagé le monde, aucun compte n’avait été tenu de ces multiples avertissements. Le brave professeur Dupin, qui préside cette commission, n’a de cesse de s’étonner de cet aveuglement et aussi qu’on ait pu oublier à ce point l’importance de la poésie dans la vie humaine. Espérons donc voir nommer une commission de ce genre une fois jugulée la pandémie actuelle.
(1) « La force d’une idée », LLL, 2019 (2) « L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au Marché total », Le Seuil, 2010. (3) “La Gouvernance par les nombres”, Fayard, 2015. (4) « Le travail n’est pas une marchandise. Contenus et sens du travail au XXIe siècle », Paris, Editions du Collège de France, 2019. (5) « Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil », Paris, Editions du Collège de France, 2019.
15. Un peu d’humour dans ces moments difficiles : Les gestes barrières
16. Compte-rendu de la séance Apéro philo qui a eu lieu en visiozoom le 9 juin 2020
Texte établi par le collectif Ataraxia
Il y a eu 11 connexions avec en tout, compte tenu des couples, 13 personnes. Deux connexions étant instables, nous avons perdu deux participants en cours de route. De plus, deux autres participants potentiels, peu familiers avec zoom, n’ont pas réussi à se connecter. Le débat a duré près de 2 heures et quart. Le thème était « Les enjeux du déconfinement et la cause climatique : responsabilité individuelle et collective ? » Nous espérons tous pouvoir faire la prochaine session en présentiel…
En introduction un texte de Bruce DEVERNOIS lu par Sylvia VERGNERES résume rapidement les points développés ci-dessus :
1. « Le coronavirus ne va pas disparaître cet été » selon Philippe Sansonetti, professeur au Collège de France et l’un de nos plus grands épidémiologistes. Un rebond inévitable nous pend au nez si nous ne réussissons pas notre déconfinement. Pour cela, selon lui, il faut principalement que nous testions, testions et encore testions surtout les porteurs sains.
2. Il nous faut penser l’après Covid 19. Jean-Marc Jancovici argumente devant les étudiants de Sciences Po, pourquoi un retour à l’avant crise sanitaire est impossible. Il explique pourquoi il n’y aura pas de redémarrage de l’économie et plusieurs millions de chômeurs en plus : en particulier parce que nous nous heurtons à une raréfaction des ressources ce que n’a jamais pris en compte la théorie économique puisque cette dernière ne parle que d’une combinaison entre capital et travail. Du fait du manque physique de ressources, la croissance ne peut être perpétuelle…
3. Les scénarios possibles pour payer la facture de la crise sont évoqués par Jean Tirole, prix nobel d’économie en 2014. Le coût direct du confinement que nous avons connu du 16 mars au 11 mai 2020, sera d’environ l’équivalent d’un mois de perte économique ou 8 % du PIB annuel auxquels il faut ajouter les coûts indirects, au total probablement plus que les 10 % de récession envisagés actuellement par le gouvernement, soit environ 250 milliards d’euros. Il existe quatre façons de payer : 1 Répudier la dette, solution très risquée 2 Augmenter les impôts, solution très risquée également 3 Monétiser la dette mais appauvrissement massif des plus démunis ! 4 Organiser la solidarité entre les Etats au sein de l’Europe : donc in fine rachat massif des dettes par la Banque Centrale Européenne (la BCE) Cest ce que Jean Tirole pense qu’il va se passer dans les faits…
4. Pablo Servigne présente l’entraide : bonne nouvelle, à travers de multiples exemples du règne animal, Pablo Servigne, montre qu’en cas de difficultés majeures, c’est l’entraide et la solidarité qui joueraient en premier lieu entre les êtres humains…
5. En point 5, René Girard, philosophe et anthropologue, nous parle de la violence et de sa place dans la culture humaine …
6. En point 6, nous sont présentées les 5 stratégies de réussite de lutte contre le covid-19 :
- Effectuer des tests
- Isoler les personnes infectées
- Désinfecter
- Respecter la distanciation sociale (ou plutôt spatiale)
- Se laver les mains avec du savon ou utiliser du gel antiseptique
8. En point 8, le confinement a été bon pour la qualité de l’air, mais attention cela risque de repartir de plus belle
10. En point 10, la convention réunissant des citoyens tirés au sort à la suite de la crise des gilets jaunes souhaite que la sortie de crise qui s’organise sous l’impulsion des pouvoirs publics ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l’humain et de la biodiversité. Elle ajoute que cette crise nous concerne tous et ne sera résolue que grâce à un effort commun, impliquant les citoyens dans la préparation et la prise de décision. Pourvu que la Convention Citoyenne soit écoutée par les pouvoirs publics qui s’étaient engagés à traduire ses propositions en projet de loi…
11. En point 11, planter mille milliards d’arbres est nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique mais pas suffisant.
12. En point 12, selon le chercheur Thierry Lebel, membre du GIEC, Il existe une différence fondamentale entre le Covid-19 et le dérèglement climatique. Le Covid-19 est surmontable et ne va pas faire disparaître l’humanité. En revanche, l’inaction en matière climatique nous fera sortir des mécanismes de régulation systémiques, conduisant à des dégâts majeurs et irréversibles. On peut s’attendre à une succession de chocs variés, de plus en plus forts et de plus en plus rapprochés : canicules, sécheresses, inondations, cyclones, maladies émergentes. La gestion de chacun de ces chocs s’apparentera à celle d’une crise sanitaire du type Covid-19, mais leur répétition nous fera entrer dans un univers où les répits deviendront insuffisants pour rebondir, et nous sommes menacés d’effondrement. La crise du Covid-19 enseigne l’impérieuse utilité de l’action publique. Il ne faut pas confondre récession et décroissance de nos productions insoutenables. Au sortir de la crise sanitaire, les pays industrialisés auront besoin d’un plan de transformation vers une société dans laquelle chacun puisse vivre dignement, sans mettre en péril les écosystèmes. L’ampleur du recours indispensable à l’argent public – qui dépassera tout ce que l’on a pu connaître – offre une occasion unique : conditionner les soutiens et les investissements à leur compatibilité avec l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce changement.
14. En point 14 vous lirez une interview d’Alain Supiot, l’un de nos plus grands juristes actuels, notamment sur la redécouverte de la nécessité de l’action publique avec la crise du Covid-19 ainsi que sur le nécessaire et complet bouleversement des rapports des salariés avec leur employeur en arrêtant d’échanger dans le cadre du contrat de travail leur assujettissement aux ordres des employeurs contre la promesse d’un salaire et d’une protection sociale toujours plus renforcée, tout cela au détriment du sens et du contenu et donc de l’intérêt au travail… Il oppose également la globalisation actuelle, avatar des expériences totalitaires, versus une mondialisation nécessaire. Il parle également des avancées fondamentales du Conseil National de la Résistance au sortir de la 2ème guerre mondiale et de la nécessité de la poursuite de cette œuvre.
Les points 7, 9 et 13 traitent respectivement de la façon dont sont comptés les morts du Covid-19 dans différents pays, de la situation en matière de recherche de traitement et vaccin contre le Covid-19 et des stratégies adoptées par différents pays pour lutter contre le Covid-19.
15. Enfin un peu d’humour en point 15 Allez voir ces gestes barrières vus par les africains. Une petite séquence rigolote pour conclure cette présentation générale aride…
Ensuite Gabriel Poisson, professeur de philosophie au lycée d’Argentan, fait l’introduction suivante :
Il est évident que l’année 2020 restera attachée dans les esprits à l’épidémie de coronavirus, lequel a fini par prendre le nom très savant de “Covid-19”, comme si nos spécialistes de la santé nous invitaient à en relativiser le caractère exceptionnel, le classant comme variété d’une espèce de virus assez fréquent, car, rappelons-le, les épidémies apparaissent assez fréquemment, fait apparemment étonnant pour nombre d’occidentaux dont la dernière épidémie remonterait à la grippe espagnole.
L’épidémie de coronavirus a d’abord été assez peu prise au sérieux ; en France, il me semble, un certain manque de préparation a sans surprise, déclenché le désir de trouver des coupables. Si nous finirons très certainement par en trouver, je doute que cette entreprise ait beaucoup d’effet si ces mesures ne s’accompagnent pas d’une réflexion globale à propos des causes d’une telle maladie, à la manière de ces soignants qui, sans être pour autant mécontents d’être applaudis, n’en demandent pas moins que les institutions leurs donnent les moyens véritables de poursuivre leur action dans de dignes conditions. Ces applaudissements, à mon humble avis, ne sont pas sans rappeler le cri devenu peu à peu slogan d’un “je suis Charlie”, témoignage à l’échelle d’un pays de la surprise d’être confronté à un terrorisme que l’on croyait disparu, ou bien réservé, habituellement, comme le virus ebola, à d’autres contrées que les nôtres.
La maladie est là ; il faut en déterminer les causes, quant à l’avenir, nous ne pouvons savoir ce qu’il sera, mais nous pouvons ensemble partager nos idées de manière à déterminer ce qu’il devrait être, et c’est ici que nous rencontrons la philosophie, dans ses perspectives morales, comme la question de Kant : Que dois-je faire ? Que m’est-il permis d’espérer ?
Pas une question, donc, mais deux, que nous pouvons remettre au goût du jour, si j’ose dire, dans ce contexte, et envisager un avenir à même de poser les conditions d’une vie heureuse, du bonheur donc, ou au minimum vers ce qu’Épicure aurait appelé l’absence de troubles du corps et de l’âme, aponie et ataraxie. Dans quelle mesure la recherche des causes du coronavirus, de sa propagation, nous invite-t-elle à dessiner les conditions d’un futur envisageable pour l’humanité ?
Le Covid-19, et après ? Quelles responsabilités individuelles et collectives face aux enjeux climatiques et les éventuelles crises à venir ? Comment associer le collectif, le global, le local et l’individuel ?
Trois axes peuvent se dessiner, sans prétendre ici à l’exhaustivité, car il n’est pas possible de penser tous ces problèmes de manière isolée.
- D’abord, quelle direction doit prendre l’économie ? Pensez-vous que la Banque centrale européenne doive accorder aux États la souveraineté dans le rétablissement de leur économie ? L’État doit-il se mêler d’économie ? Comment ? L’urgence de la situation est-elle une occasion de modifier notre modèle industriel ?
- Ensuite, ce questionnement est indissociable d’une réflexion à propos de l’écologie : de quelle écologie voulons-nous ? Allons-nous vers une écologie autoritaire et conservatrice ? (Référence à l’alliance autrichienne entre des écologistes et un parti d’extrême-droite). Peut-on envisager un changement écologique radical en raison de l’urgence de la situation tout en s’inscrivant dans une légitimité démocratique ?
- Enfin, ces problèmes nous amènent tout naturellement à la politique. Doit-on envisager de nouvelles formes de citoyenneté ? Existe-t-il encore un espace d’expression citoyen tel que les Lumières l’avaient imaginé ? Les aspirations démocratiques contemporaines, localistes dans une certaine mesure, peuvent-elles être efficaces, et s’opposent-elles nécessairement à la centralisation, c’est-à-dire à la concentration des décisions dans les mains des institutions gouvernementales ?
Quel rapport y a-t-il entre l’économie et les Etats ?
Alain AZNAR lance le débat en rappelant les points suivants :
Ce qui est en jeu, c’est ce que nous avons à gagner ou bien à perdre.
- L’expérience du confinement partagée par un peu plus de la moitié de l’humanité, nous a enseigné que l’on pouvait perdre beaucoup… Cette pandémie nous a rappelé notre vulnérabilité et le bilan n’est d’ailleurs pas fini. Le confinement, c’est faire l’expérience de la perte. Face à des phénomènes extraordinaires telle que la crise liée au COVID-19, l’humanité est confrontée à des choix.
- La question à poser en introduction de ce débat est la suivante: si, comme nous le dit HEGEL, “l’expérience et l’histoire nous enseignent que peuples et gouvernements n’ont jamais rien appris de l’histoire”, comment la pandémie pourrait-elle changer cela ?
De nombreuses réactions fusent parmi les participants, notamment s’agissant des femmes qui pourraient bien cette fois-ci faire changer la donne.
Emmanuel BECKER propose de revenir sur la notion de responsabilité. Etre responsable, c’est décider. C’est user de sa capacité d’agir. C’est être auteur de ses actes. Etre responsable de mes actions, c’est aussi exister. La notion de responsabilité renvoie au jugement, aux valeurs éthiques et convoque les notions de risque, de vulnérabilité, d’obligation, d’autonomie, de devoirs et d’obligations, d’éducation également, voire de transgression. La responsabilité, c’est répondre de soi mais également répondre de l’autre, répondre à l’autre. Que laissons-nous aux générations futures ? Pour Hans JONAS, la responsabilité n’est plus seulement une réponse à mes actes mais cela m’engage vis-à-vis de l’avenir. C’est tout l’enjeu de la nouvelle conscience écologique (écologie politique). Cela questionne les besoins des individus et permet de prendre la mesure des impacts des actions menées. LEVINAS est évoqué en référence à la philosophie de la rencontre qui implique le rapport à autrui, l’intégrité et la solidarité.
Une intervenante évoque les « mécanismes de la folie » en référence au dernier livre de BHL : Ce virus qui rend fou. Nous nous serions « fait avoir par le Coronavirus » ! Les médecins experts et les gouvernants auraient-ils usé d’un abus d’autorité ? Nous sommes pris en étau entre la sécurité et la santé. Mais il ne faut pas sous-estimer la responsabilité collective. « Ne pas sacrifier la liberté à la sécurité » disait ROUSSEAU ! Plus que de la folie, la sidération est à l’œuvre.
La crise sanitaire a suscité la sidération. Cela s’est accompagné d’une infantilisation des citoyens. Le peuple français n’a-t-il pas fait preuve d’une incroyable docilité face aux décisions du gouvernement ? La relation entre le COVID et le politique interroge. Indéniablement, cette situation a à voir avec le pouvoir. Le retour aux totalitarismes est-il à craindre ? Des exemples dans le monde peuvent parfois nous le faire penser… Néanmoins, l’épisode Coronavirus a été une entorse importante au modèle libéral et en mettant à l’arrière plan les principes capitalistes prônés par les politiques. Le courage politique n’est-il pas l’expression de la responsabilité individuelle et collective ? Cela ne s’inscrit-il pas dans un cheminement antérieur déjà perceptible avec l’éveil politique qui a accompagné le mouvement des Gilets jaunes ?
Face à ma responsabilité, que puis-je faire moi, à mon niveau local ? S’engager, c’est faire acte de citoyenneté ! Albert Camus est évoqué avec la question de l’engagement. Son ouvrage La Peste a un écho étonnant ! Assiste-t-on à un retour de l’engagement, l’émergence d’une conscience politique et sociale ? N’est-on pas en train d’assister à un tournant avec la démocratie participative ? Ne peut-on pas imposer des solutions au pouvoir ? Quelle est la capacité d’un peuple à se déterminer ? « L’histoire va vers l’amélioration », selon HEGEL…
Y aura-t-il un avant et un après COVID ? Un participant considère que rien ne va changer. Ou en tout cas pas avant 50 ans ! Le capitalisme est une grosse machine avec beaucoup d’inertie. Mais les technologies vont évoluer. Pour lui l’écologie ne va pas connaître de grands changements sauf d’ici 5 à 10 ans. Politiquement c’est inquiétant et ça permet aux tendances totalitaires de se développer. Les pouvoirs sont trustés par les politiques et cela risque de se confirmer davantage… Sauf peut-être en local ? Pour certains participants, il y a besoin d’un équilibre entre le local et le global.
Un autre participant pense que cela passe par le développement de l’autonomie, notamment collective en particulier s’agissant d’alimentation. S’agissant de l’autonomie, il en va de la qualité de vie… Mais comment les politiques vont-ils réagir ?
Il en va aussi de la liberté de décider de ses propres lois. « Le bonheur, c’est la capacité à établir ses propres lois » pour ROUSSEAU.
Le débat évolue alors sur la notion de désir : désir de consommer, désir d’écologie… Le désir est essentiel pour repartir… Mais le désir peut être rapproché de l’infantilisation, du plaisir et du bonheur que procure quelque chose qui nous est extérieur et renvoie aux besoins fondamentaux… Le désir qui se connaît, le désir qui ne se connaît pas est déterminé par l’extérieur. Le désir, par essence, c’est ce que l’on n’a pas (André COMTE-SPONVILLE).
Pour SPINOZA, le désir est à distinguer du manque : ne pas être esclave de ses désirs venus de l’extérieur. Le désir est mimétique selon René GIRARD. Mais puis-je déterminer mon désir ? Lorsque l’on ne contrôle pas ses désirs, c’est que l’on est conditionné.
Le bonheur, c’est peut-être l’économie de la subsistance qui renvoie au « connais-toi toi même » de SOCRATE. S’en prendre à soi-même… Quid de ce que disait NIETZCHE : « sois ton désir », « détermine ta vie ».
Mais alors la « société de contrôle » dénoncée par DELEUZE n’est pas loin.
Un long débat s’engage alors sur la reconnaissance faciale en Chine et l’omniprésence devenue presque habituelle des caméras dans l’espace public, chez soi… Surveillance ou protection ? La gestion des données numériques et leur destination interrogent plus encore. Le « Big data » peut devenir un outil policier… N’est-ce pas à rapprocher de la notion de confiance ? Un monde de confiance ou d’absence de confiance influence les relations humaines.
Un participant s’insurge : le respect notamment des autres est fondamental…
Oui, mais tout cela ne dépend-il pas de la classe sociale et de l’éducation ? Apprendre…
La crise sanitaire n’est-elle pas un appel à anticiper les crises à venir, notamment la crise climatique ? On va droit dans le mur ! La catastrophe est déjà là.
Mais le changement de société est déjà à l’œuvre car les initiatives locales et l’engagement des jeunes sont réconfortants… Faire vivre ses idées, c’est déjà amorcer un changement !
La session se conclut sur cette note optimiste.